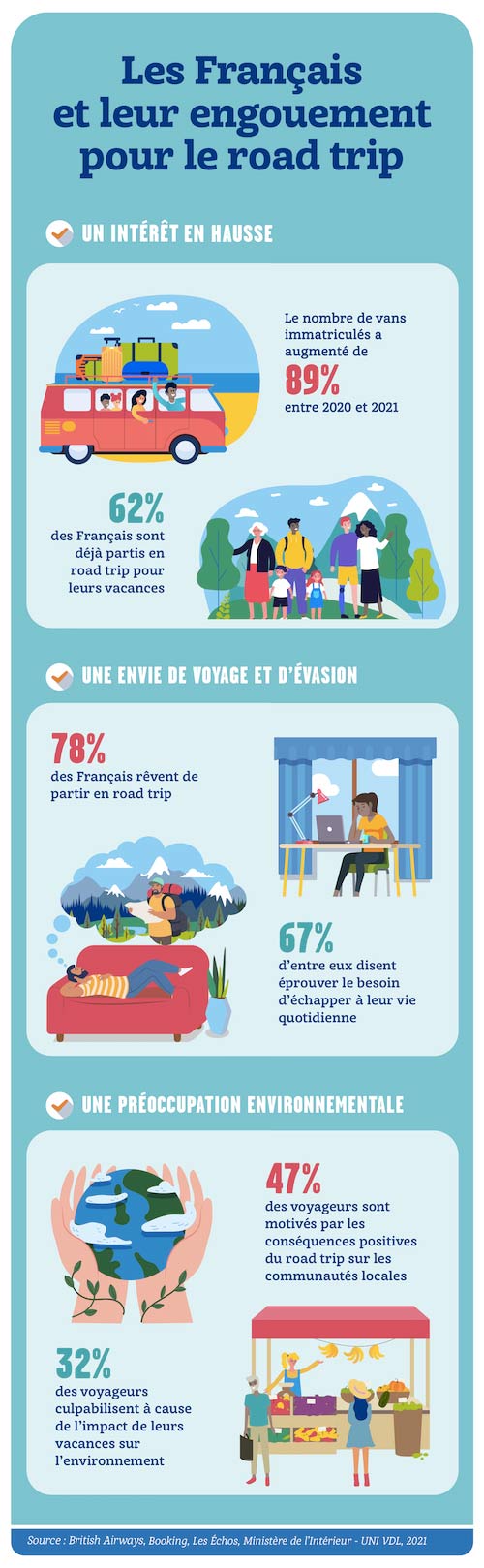La France compte plus de 2,7 millions d’étudiants. C’est une bonne nouvelle : la démocratisation de l’enseignement supérieur est là. Mais encore faudrait-il que les étudiants aient la possibilité et les moyens de se loger. C’est loin d’être une évidence aujourd’hui. Dans le parc public, on compte 210 000 logements gérés par le Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires), pour 700 000 boursiers (1), quand moins d’un tiers des étudiants vivent chez leurs parents. La plupart sont donc contraints de trouver à se loger dans le privé, où les tarifs sont plus élevés : comptez en moyenne 550 € par mois, et jusqu’à 800 € à Paris (2)… Le coût n’est pas le seul obstacle : le nombre de « candidatures » que suscite, dans les centres urbains, le moindre studio disponible à la location témoigne du déséquilibre entre l’offre et la demande. Alors face à cette pénurie, de plus en plus de programmes transforment en logements des bâtis et des matériaux conçus pour une toute autre fonction.
Lire aussi : La précarité étudiante aggravée par la crise sanitaire
Logement étudiants : des initiatives prometteuses
Au Havre, depuis 2010, ce sont d’anciens conteneurs maritimes qui abritent désormais une centaine de studios au sein de la résidence universitaire baptisée « A Docks ». Disposés sur une ossature métallique de quatre étages, avec de larges baies vitrées découpées dans la tôle, ils ont gardé l’esthétique des engins de transport portuaire, mais offrent à l’intérieur des appartements isolés de 24 m2. Le tout pour un loyer de 300 euros environ charges comprises, et à moins de deux kilomètres de l’université du Havre (76)… De quoi convaincre de nombreux étudiants. L’objectif affiché par le Crous et la collectivité est de répondre au manque de logement de manière économique et rapide, avec un coût 25 % moins cher qu’une résidence lambda, et des délais de réalisation imbattables (5 mois).
Reste que le bilan n’a pas été à la hauteur des attentes : sans doute parce que le projet était expérimental, chaque logement a coûté 50 000 euros, soit un peu plus qu’un hébergement Crous classique. À ce jour, l’expérience n’a pas été reconduite…
Mais malgré certains obstacles, transformer l’existant pour y loger les étudiants est une tendance qui s’affirme. À Paris, ce sont d’anciens bains-douches municipaux et d’anciens bureaux (le siège de Zodiac Aero Electric) qui ont été modifiés pour accueillir des résidences étudiantes privées. Plus original encore, un garage Citroën, dans le 14ème arrondissement, a été restructuré en 68 logements gérés par le Crous, auxquels s’ajoutent 4 000 m2 d’ateliers et 1 500 m2 de commerces.
Plan Común, l’agence d’architecture qui a réalisé le projet, défend « une démarche durable de réemploi du bâtiment existant ». Ici l’ambition est moins financière que celle d’une économie de moyens, visant à « minimiser les démolitions et constructions », pour « relever les défis environnementaux et la gestion des ressources du XXIe siècle ». C’est là le principal atout de ces métamorphoses. Car si réhabiliter, que ce soit en gardant les mêmes fonctions ou en changeant les usages, ne coûte pas toujours moins cher qu’un logement neuf, le bénéfice écologique est bien réel.
Transformer et réhabiliter l’ancien pour créer des logements durables
Ces démarches permettent en effet de diminuer l’usage de nouvelles matières premières (et dans le même temps, le recours aux transports), et de réduire la pollution et les nuisances occasionnées par le chantier. « C’est vraiment un changement de paradigme qui s’amorce sur l’emploi de la matière », se réjouit l’architecte Anne Pezzoni, qui travaille actuellement à la réhabilitation d’un parking en logements.
Transformer l’existant présente un autre atout de taille : permettre l’accès à des situations géographiques idéales, alors que les nouvelles constructions sont souvent excentrées, et que le foncier en cœur de ville est déjà occupé. L’argument a convaincu la ville rose et le Crous d’Occitanie : « Trouver du foncier est un enjeu majeur et complexe, pour lequel la réhabilitation de locaux est une piste que nous développons », explique Dominique Froment, la directrice du Crous. Dont acte : les bureaux de l’ancienne inspection académique de la Haute-Garonne, à proximité immédiate du centre-ville de Toulouse, sont en cours de transformation pour y accueillir 161 logements étudiants sur 6 niveaux, qui formeront la « résidence Duportal ».
« L’adaptation en logements d’un bâtiment qui n’est pas dédié à l’habitat à l’origine n’est pas toujours possible, mais c’est une piste intéressante, qui se développe depuis une quinzaine d’années. Je pense qu’à l’avenir on démolira moins »
Joseph Almudever, architecte
Pour l’architecte Joseph Almudever, qui réalise le projet au côté d’Alexandre Brau-Mouret, le chantier doit permettre de révéler les qualités de l’édifice historique et de respecter son identité : « C’est un bâtiment très riche des années 60. De petits galets de la Garonne cerclent les piliers, le sol du rez-de-chaussée est en marbre de Saint-Béat … Et avec ses pilotis en béton, il s’inscrit dans la continuité du travail de Le Corbusier ». Le couloir a été élargi pour permettre d’accueillir du public, et ce sont désormais trois chambres qui tiennent sur deux trames porteuses. L’architecte insiste sur l’importance de penser la réversibilité des usages : concevoir une construction suffisamment flexible pour qu’elle puisse être adaptée à de futures fonctions.
« La résidence Duportal est la première qui ouvrira dans l’Académie suite à la transformation de bureaux en logements, mais ce n’est très certainement pas la dernière », promet la directrice du Crous Occitanie. Une ambition nécessaire : alors que ses services enregistrent en moyenne 12 demandes pour 1 place disponible en résidence, il faudra davantage qu’un projet exemplaire pour améliorer les conditions de logement des étudiants.
Lire aussi : Jeunes : tout savoir pour gérer son budget logement
(1) Crous, Chiffres clés 2020.
(2) Repères 2020 observatoire vie étudiante
http://www.ove-national.education.fr/wp-content/uploads/2021/01/Brochure_Reperes_2020.pdf