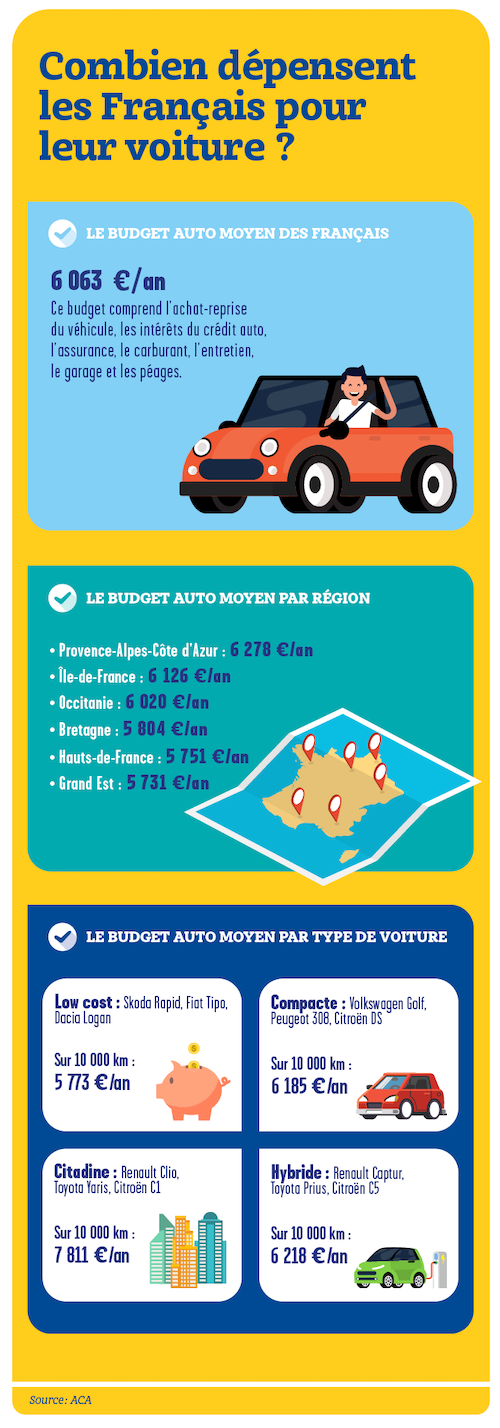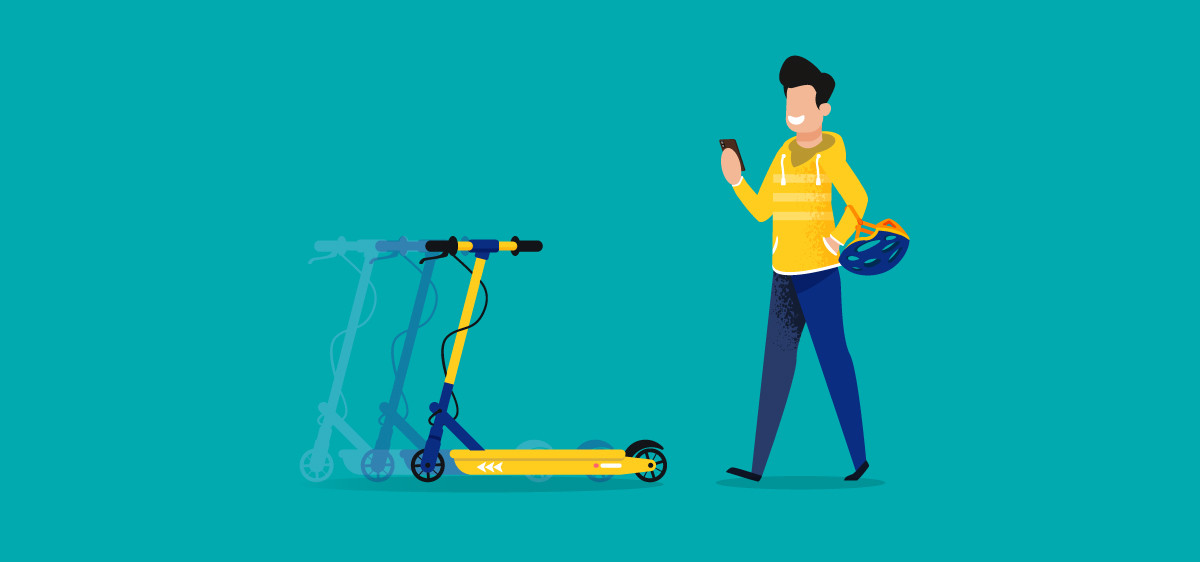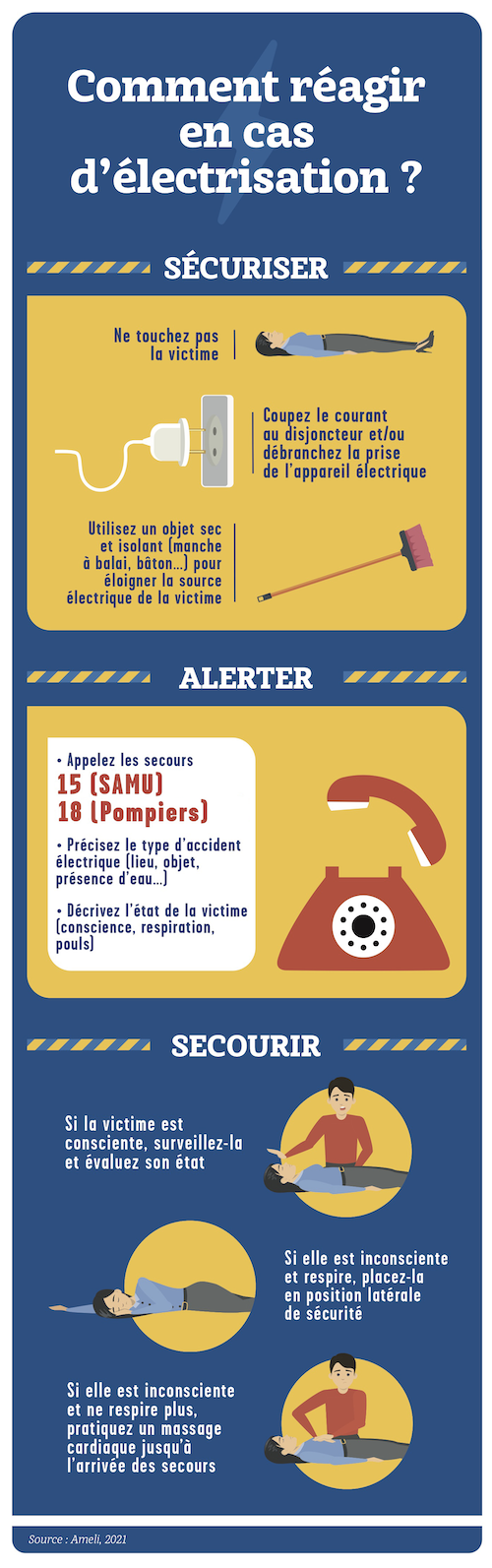Crainte ou hantise pour les uns, mauvais souvenir pour d’autres : l’intrusion de voleurs à domicile, même si elle a lieu sans effraction ou dégradation, peut-être une expérience traumatisante. Tour d’horizon des solutions innovantes permettant de protéger votre habitation.
Mis à jour 27/03/21
Si elle rime naturellement avec soleil et vacances, la saison estivale est également la période préférée des cambrioleurs (+ 29 % de cambriolages en juillet-août (1)) qui n’hésitent pas à pénétrer dans les logements même lorsqu’ils sont occupés. En particulier si vous habitez dans une grande ville où le risque est deux fois plus élevé qu’en milieu rural (1). Pour éviter ce préjudice de taille ? Pensez aux nouvelles technologies pour protéger votre habitation et avoir l’esprit tranquille !
1
La caméra surveillance connectée
La vidéosurveillance à domicile s’est largement démocratisée ces dernières années. Faciles à installer et à utiliser, les caméras permettent de garder un œil chez vous sans y être. Les plus perfectionnés prennent – en cas de mouvements détectés – des photos ou vidéos qui peuvent vous être transmises en temps réel par e-mail, SMS, ou via une application dédiée. En cas d’intrusion, vous n’avez plus qu’à donner l’alerte aux gendarmes ou aux policiers.
Chiffre-clé
La présence d’une alarme dans une habitation réduit de 32 % (2) le risque de cambriolage.
2
Le robot intelligent
Petit par la taille (ce qui lui assure une certaine discrétion), le robot connecté se balade partout dans votre logement. Dirigeable à distance depuis un smartphone, il se recharge en toute autonomie et, grâce à sa caméra, vous alerte en cas de cambriolage en vous transmettant des vidéos de l’intrusion. Certains robots sont même équipés d’un microphone qui vous permet d’avoir une oreille sur ce qu’il se passe chez vous ou encore d’interagir avec vos animaux de compagnie en votre absence.
3
La serrure électronique
En place chez les professionnels du tourisme depuis des années, les systèmes d’ouverture de porte sans contact sont désormais plébiscités par les particuliers. Plus sûre que la serrure classique, la serrure électronique vous permet de piloter à distance, à l’aide de votre smartphone ou de votre ordinateur, l’ouverture ou la fermeture des portes de votre logement. Un système qui vous permet de sécuriser les allées et venus dans votre habitation sans avoir besoin des clés.
Bon à savoir
Nouvelles technologies, mais pas sans risque
Si vous optez pour l’installation d’une serrure électronique, privilégiez les produits certifiés a2P@ afin d’éviter tout dysfonctionnement ou piratage informatique.
4
L’alarme génératrice de brouillard
Enfumer la pièce est une façon aussi efficace qu’impressionnante de dissuader les cambrioleurs. L’alarme se déclenche quelques secondes après le début de l’infraction. Une épaisse (et inoffensive pour la santé) fumée opaque se diffuse alors dans la pièce, empêchant les cambrioleurs de se repérer dans votre logement et de poursuivre leur action. À noter que ce type de système peut aussi être actionné par un bouton ou une télécommande si vous êtes présent durant les faits.
Vous êtes propriétaires ?
Pensez à bien assurer et protéger votre bien immobilier pour garder l’esprit tranquille.
L’Essentiel de l’article
- La caméra de surveillance est le dispositif le plus simple à installer et à utiliser.
- La serrure électronique vous permet de contrôler les allées et venues dans votre habitation.
- Optez pour des systèmes certifiés pour garantir votre sécurité.