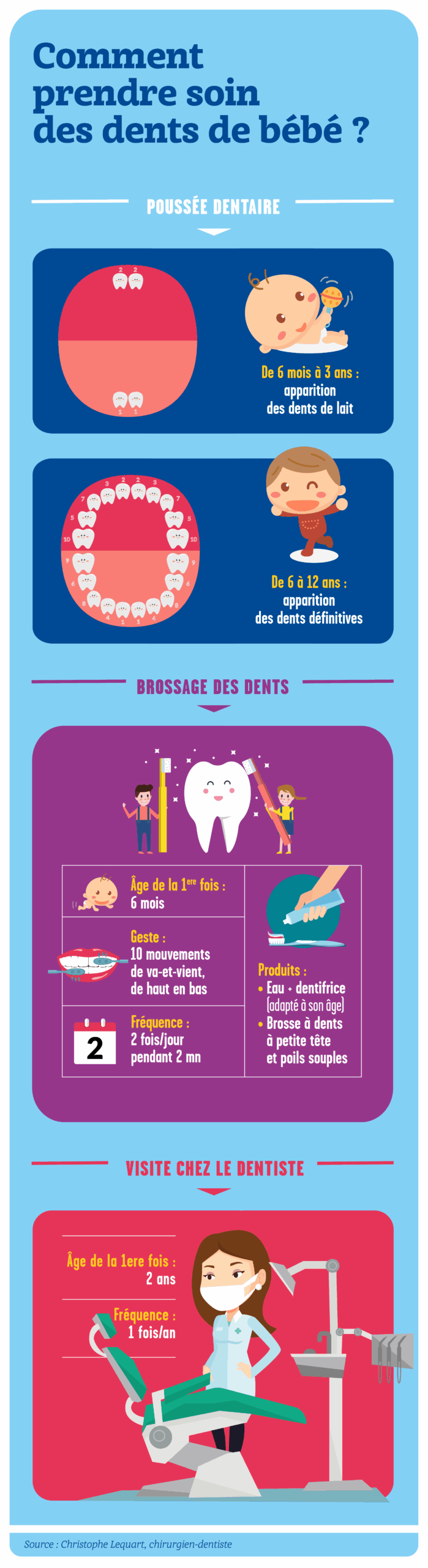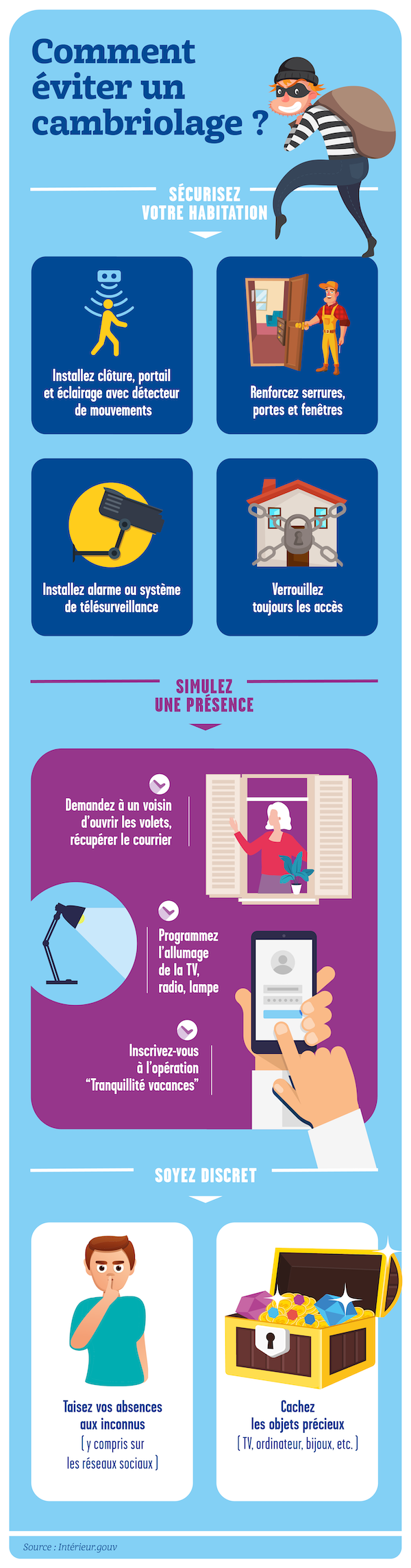Si mieux consommer dans les assiettes est l’un des enjeux de l’économie circulaire et collaborative, cela a aussi un impact sur l’environnement et le développement de l’agriculture. De plus en plus de consommateurs cherchent ainsi à améliorer leurs modes de consommation alimentaire et privilégient l’achat de produits locaux ou d’origine française. Ces circuits d’approvisionnement dits courts réduisent les intermédiaires entre producteurs et particuliers, mais surtout, permettent d’accéder à des produits frais et de saison. Le point sur ce nouveau mode de consommation aux multiples bénéfices.
1
Qu’est-ce qu’un circuit court ? Définition
Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA), on parle de circuit court pour toute vente reposant sur un intermédiaire maximum entre le producteur et le consommateur final. Il existe donc différents types de circuits courts :
- du producteur au consommateur en passant par le commerçant ;
- du producteur au consommateur en passant par le restaurateur ;
- du producteur au consommateur en passant par l’artisan transformateur (boucher, boulanger, etc.).
L’Inra (l’Institut national de la recherche agronomique) nuance quelque peu cette définition en y intégrant la notion de géolocalisation et en tolérant la présence de deux intermédiaires entre le producteur et le consommateur final. La seule condition : qu’il existe une proximité géographique entre le producteur et le consommateur. En bref, vous consommez en circuit court lorsque vous achetez ou consommez des ingrédients et produits au plus près de chez vous, à moins de 160 kilomètres maximum (1), directement auprès de producteurs, restaurateurs ou distributeurs locaux, tout en limitant le nombre d’intermédiaires.
Le saviez-vous ?
Quand la vente se fait directement du producteur au consommateur, on parle de vente directe.
2
Consommer local : un mode de consommation de plus en plus plébiscité
Prise de conscience écologique, envie de consommer mieux à la fois pour sa santé, son budget et l’environnement, ou encore de soutenir l’économie et agriculture locale, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à plébisciter le circuit court. Un sondage Ipsos (2), réalisé en février 2014, révélait déjà que 41 % des Français achetaient souvent, voire très souvent, des produits locaux, contre 20 % rarement ou jamais. Des habitudes de consommation qui semblaient donc déjà bien ancrées puisque 69 % annonçaient en avoir consommé davantage au cours de ces deux dernières années et 59 % affirmaient vouloir en consommer toujours plus dans les six prochains mois. De quoi laisser présager que la tendance allait se poursuivre. Et ça n’a pas manqué !
Toujours selon un sondage Ipsos (3), réalisé en 2019, 82 % des Français privilégient l’achat de produits d’origine française et 77 % l’approvisionnement auprès de producteurs locaux. Des chiffres en nette progression qui montrent l’intérêt toujours grandissant des Français pour les produits locaux. Seulement 4 % d’entre eux ne se considèrent pas du tout préoccupés par l’origine géographique. Ainsi, de nombreux ménages ont revu leur mode de consommation, et privilégient les circuits courts, leur permettant ainsi de connaître l’origine des produits.
Chiffre-clé
Entre 2014 et 2019, le nombre de Français privilégiant l’achat de produits locaux a augmenté de 36 %. (1)(2)
Bon à savoir
Ne pas confondre manger bio, manger local et manger équitable
Pour beaucoup, circuit court rime avec « production et conditionnement local », « produits de saison » et « bio ». Attention aux amalgames. L’agriculture biologique dite « bio » consiste en la non-utilisation de produits chimiques de synthèse et d’OGM, quand le « local » renvoie seulement à la notion de proximité du lieu de production. Toutefois, rien ne certifie que les produits locaux n’ont pas été traités avec des substances chimiques. Il faut donc être vigilant sur le mode de production. De son côté, le commerce équitable contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales (juste prix de vente) et en garantissant les droits des producteurs. Aujourd’hui, tout comme pour les produits biologiques, des labels permettent aux consommateurs de rapidement identifier les produits issus du commerce équitable en magasin.
3
Les avantages et les inconvénients du circuit court
Lorsque vous optez pour une consommation en circuit court vous :
- participez à l’économie locale ;
- favorisez l’aide et le soutien aux producteurs locaux ;
- respectez davantage l’environnement en limitant les intermédiaires (et donc le transport des marchandises).
Grâce à l’achat en circuit court, vous permettez aux producteurs de fixer leurs prix. En contrepartie, le consommateur est assuré d’avoir des produits de saison avec une bonne connaissance et traçabilité du produit, pour une alimentation mieux contrôlée. Tout le monde est gagnant !
Le saviez-vous ?
Les aliments produits localement et de saison polluent dix fois moins que les autres. (4)
4
Comment adopter ce nouveau mode de consommation solidaire ?

Pour devenir un adepte du circuit court, vous pouvez tester différentes options et voir celle qui vous correspond le mieux. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que vous avez l’embarras du choix !
Vous pouvez, selon vos préférences :
- vous rendre directement à la ferme ou à la cueillette en famille : il paraît qu’on n’est jamais si bien servi que par soi-même ! Alors renseignez-vous auprès de la ferme près de chez vous pour voir si elle propose de la vente en direct ou rendez-vous dans un lieu dédié à la cueillette. Vous pourrez directement choisir vos produits. Et pour cela, même plus besoin d’être à la campagne. Des fermes s’installent en ville grâce à la permaculture, permettant au plus grand nombre de venir cueillir leurs fruits et légumes près de chez eux et devenir un véritable locavore urbain ;
- acheter dans les magasins de producteurs et comptoirs locaux ;
- acheter sur les marchés locaux ; – vous rendre dans une des AMAP, Association pour le maintien d’une agriculture paysanne, où sont distribués des paniers remplis de produits de saison. Pour en trouver une près de chez vous, découvrez l’annuaire national des AMAP.
Si les consommateurs adoptent ce nouveau mode de consommation, les producteurs s’adaptent à leurs nouvelles habitudes d’achats en proposant de la vente en ligne, des services de livraison ou encore du drive à la ferme. Une partie des acteurs de la grande distribution soutient aussi l’économie locale en mettant en avant des produits de producteurs régionaux dans leurs points de vente. Vous n’avez plus qu’à choisir !
Le saviez-vous ?
La Fondation d’entreprise du Groupe Macif soutient des initiatives qui œuvrent en faveur du manger local !
L’Essentiel de l’article
- Le circuit court limite les intermédiaires entre producteurs et consommateurs.
- Ce nouveau mode de consommation encourage l’économie locale.
- Consommer local permet de mieux contrôler ce qui se trouve dans son assiette.
- Ne pas confondre manger bio, manger local et manger équitable.
(1) Unadere, Circuit court et produit local, quelles possibilités pour la restauration collective ?, 2018
(2) Ipsos, « Consommer local » : ce que veulent les Français, 2014
(3) Ipsos, Pour 79 % des Français l’origine géographique d’un produit est primordiale
(4) Insee, Des marges commerciales variées selon les produits, mais proches entre grandes surfaces, 2015