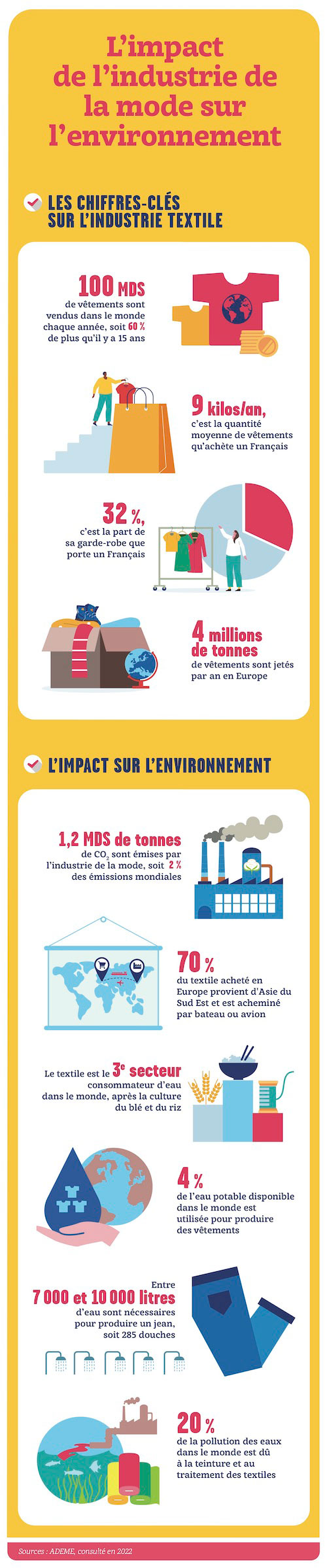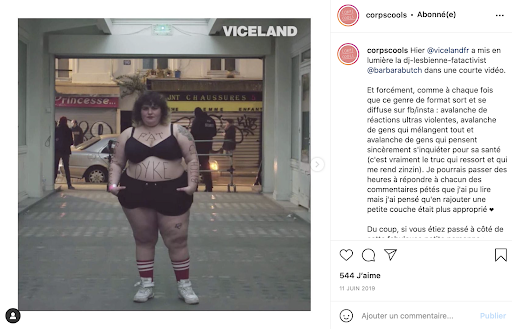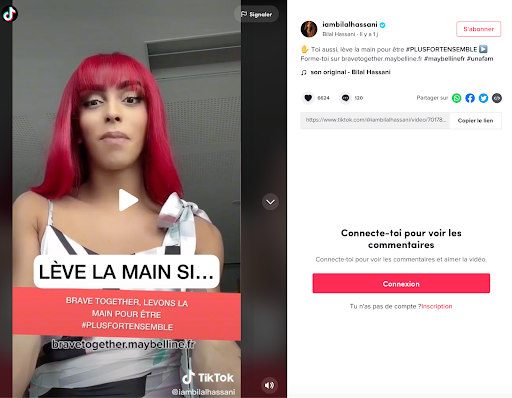Romain a mis cette ambition à exécution dès sa sortie d’école et travaille depuis un an en Asie. C’est sa quatrième expérience professionnelle, précédée de deux stages de six mois et d’une expérience d’un an en Île de France. De son côté, Olivier est chargé d’innovation d’un grand groupe d’énergie français. Après ses études d’ingénieur, il intègre cette entreprise dans laquelle il évolue depuis près de 30 ans et recrute régulièrement de jeunes diplômés.
16 % de jeunes
projettent d’étudier à l’étranger.1
Que vous ont apporté vos premières expériences professionnelles ?
Romain : Tout d’abord, mes premières expériences m’ont permis d’avoir un CV fourni avec de bons éléments permettant d’appuyer mes candidatures dans le domaine que je recherchais, ce qui est toujours mieux que de sortir d’école sans stage. Aussi, d’un point de vue purement professionnel, ça m’a permis de mettre en pratique ce que j’avais appris en cours et de développer des compétences qu’on n’apprend pas à l’école : du relationnel et des compétences transverses comme de la gestion de projet ou le management.
Olivier : Les critères de recrutement d’un jeune ingénieur sont effectivement le CV, les différentes expériences, mais cela ne fait pas tout. Il y a des choses qui ressortent d’une dimension extra-académique : il va falloir trouver chez le candidat un enthousiasme, une énergie, une ouverture vers le monde extérieur qui n’apparaissent pas dans un CV. Pour ce qui est de la découverte de compétences relationnelles, je pense que c’est une constante indépendamment des cursus universitaires et des générations : les écoles nous aident à penser, mais l’important de l’expérience professionnelle s’acquiert au contact de professionnels et cela tous les jours, depuis le premier jour de travail.
« Plus d’un tiers des jeunes estiment que leurs compétences servent avant tout à valoriser le CV ». @Jeremie_Peltier revient sur l’enquête commandée par @MacifAssurances et @j_jaures à @BVA_France sur la jeunesse française et son rapport à l’entreprise https://t.co/CPGucsoy0u
— Usbek & Rica (@USBEKetRICA) March 17, 2022
De quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien dans une entreprise ?
Romain : L’important pour moi est de faire un travail qui me plaise, dans lequel je puisse m’épanouir, et surtout apprendre. J’espère continuer à me challenger en permanence, monter en compétences et gagner en responsabilité. Je pense qu’au moment où j’atteindrai une limite d’apprentissage dans mon emploi, je ne verrai plus grand intérêt à continuer : il vaudra peut-être mieux que je change d’orientation. Je pense par ailleurs qu’il est essentiel de s’entendre avec ses collègues, car ce sont eux qui nous forment. Cela permet également de savoir vers qui se tourner si on a besoin d’aide. Pareil pour ce qui touche au management : j’ai toujours eu affaire à des managers professionnels et bienveillants, sachant faire la part des choses entre parler travail quand c’est nécessaire, et être proches de leur équipe. J’ai aussi besoin qu’on me laisse beaucoup d’autonomie. Dans mon travail actuel, je fais les heures que je veux tant que le travail est fait, et c’est quelque chose que je valorise beaucoup.
Olivier : Il faut avoir en tête que plus il y a de demande dans un secteur professionnel, plus les travailleurs sont en mesure de se montrer exigeant sur leurs conditions de travail. C’est ce qu’il se passe dans le monde de l’ingénierie : aujourd’hui, le pouvoir est du côté des diplômés, pas des entreprises. Les jeunes ont donc la possibilité du choix, bien plus qu’il ne l’était quand j’ai accédé au monde du travail. À mes débuts, on arrivait avec relativement peu de critères, tandis que les jeunes ingénieurs sont plus exigeants sur la pertinence de l’activité qui va leur être confiée, l’autonomie, la qualité de vie, la qualité de l’équipe et du management…
Dans quel modèle d’entreprise pensez-vous être le plus à l’aise pour évoluer ?
Romain : D’après mon expérience, quand on est dans un grand groupe, c’est un peu quitte ou double : si on tombe sur une bonne équipe c’est parfait, mais si on tombe sur du management un peu laxiste, ça risque d’être compliqué. Souvent, dans des groupes importants, on est un élément parmi tant d’autres, donc on n’a pas forcément tout le support dont on aurait besoin alors qu’on sort tout juste d’école. C’est pour ça qu’au début, je pense que le mieux est d’évoluer dans des entreprises un peu plus réduites et familiales. Le risque, c’est d’avoir moins d’opportunités professionnelles, ou peu de possibilité d’avoir des missions spécifiques, mais il y a plus de chances que ce soit plus confortable humainement.
Olivier : Nous avons connu plusieurs phases : il y a 20 ou 30 ans, les jeunes cherchaient de grosses PME ou des grands groupes. Puis, à la fin des années 90, tout le monde a voulu intégrer des start-ups. Aujourd’hui j’ai l’impression que ça s’équilibre un peu, que chacun va trouver ce qu’il cherche en particulier dans son expérience professionnelle. Je pense qu’on va trouver des enseignements riches quelle que soit la taille de l’entreprise où l’on va faire sa première expérience. Dans un grand groupe industriel, on va apprendre à réfléchir à grosse échelle, à raisonner grand, efficace, et avec des moyens. On va également pouvoir s’appuyer sur un environnement avec beaucoup de compétences. Mais le corollaire de cela, c’est un peu moins d’autonomie, un peu plus de complexité, un peu plus de lourdeurs administratives, et un peu moins de confiance donnée à un jeune diplômé dans sa capacité à identifier et à promouvoir des solutions qu’il aurait imaginé lui. Dans une petite structure, on pourra accéder à une expérience formatrice parce qu’on va être confronté un peu seul à des problématiques d’ingénieur, mais en revanche on aura pas cette dimension de grande échelle.
43 % des jeunes
indiquent que leur attente principale vis-à-vis de leur travail se situe au niveau du salaire. 1
Une bonne rémunération est-elle un élément décisif pour choisir une entreprise ?
Romain : Ça ne me motiverait pas à rejoindre une entreprise si elle me proposait un salaire bien en dessous de celui de mes camarades qui sont aussi sortis d’école ou de la moyenne nationale. En somme, c’est une manière de mesurer la valeur de mon travail. Pour moi, l’argent est avant tout une question de sécurité. Cela permet d’une part de vivre tous les jours, mais aussi de faire des projets, comme acheter une maison et d’anticiper des évènements de vie comme un licenciement, un décès, des voyages…
Olivier : J’observe depuis une dizaine d’années une tendance nouvelle du rapport des jeunes à leur rémunération : les jeunes considèrent qu’ils sont suffisamment payés entre 35, 38, ou 40k. Ils disent qu’ils ont « assez » pour vivre. Il y a un effet de palier sur un salaire minimum, qui garantit une certaine forme de confort et de reconnaissance sur le marché du travail, et à partir duquel le salaire ne devient plus important.
Lire aussi : « Le revenu représente la valeur de notre travail »
42 % des jeunes
disent souhaiter avoir la possibilité de travailler depuis chez eux de temps en temps. 1
Quelle place donneriez-vous au télétravail dans votre entreprise si vous aviez le choix ?
Romain : À mes yeux, le format télétravail complet n’est pas quelque chose de viable pour une entreprise : c’est trop important d’avoir un contact réel avec les gens, et je pense qu’à terme, c’est préjudiciable pour le moral de n’avoir aucun contact avec son entreprise et ses collègues, si ce n’est en visio… Je pense que beaucoup de gens se laissent aller quand ils font du télétravail. Et puis le risque, c’est aussi d’oublier qu’on travaille ! À mon sens, ça peut être viable de faire un ou deux jours de télétravail par semaine, mais de manière autorisée et pas obligatoire pour prendre en compte les gens qui préfèrent passer toute la semaine au bureau.
Olivier : Je doute que Romain soit représentatif de sa génération sur ce point : aujourd’hui, les professionnels de mon entourage me disent que la première question qui est posée à un jeune embauché est : « combien de jours de présentiel et de distanciel souhaitez-vous ? ». Le télétravail touche au lieu où l’on va exercer son activité professionnelle, ce qui est très important car il y a un enjeu autour du confort de vie qui se situe au niveau de la ruralité versus urbanité : est-ce que je vais être obligé de vivre en région parisienne pour travailler en région parisienne, ou est-ce que je peux aller vivre à Orléans ou aux Canaries parce que c’est là que j’ai envie d’être ? A mon sens, cette dimension-là va devenir de plus en plus prégnante dans le futur, jusqu’à devenir un facteur différenciant pour les employeurs
1 Baromètre Les jeunes et l’entreprise