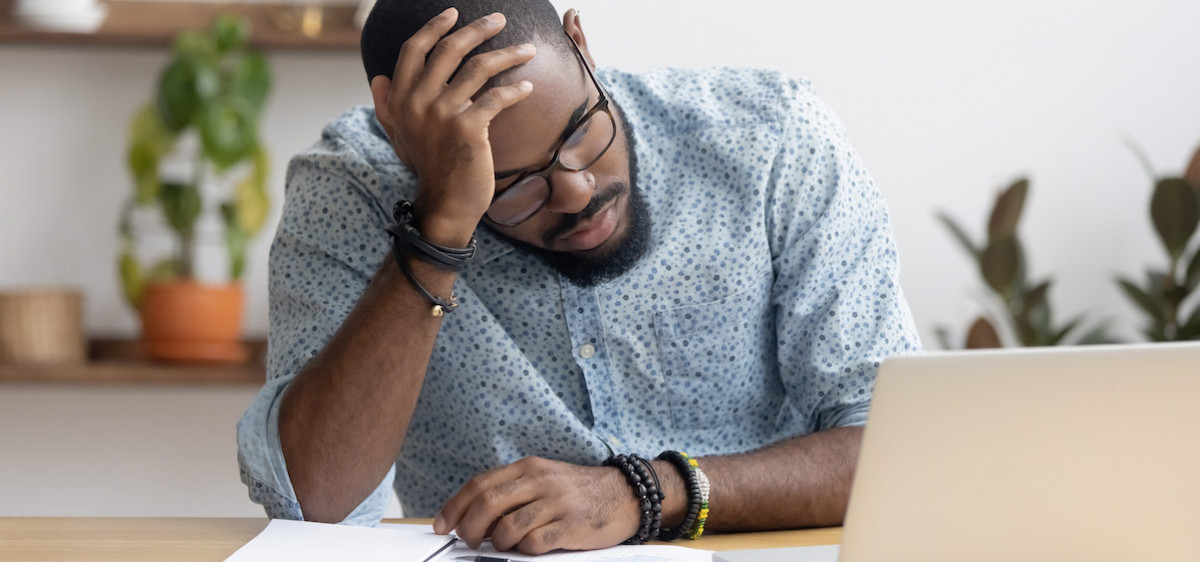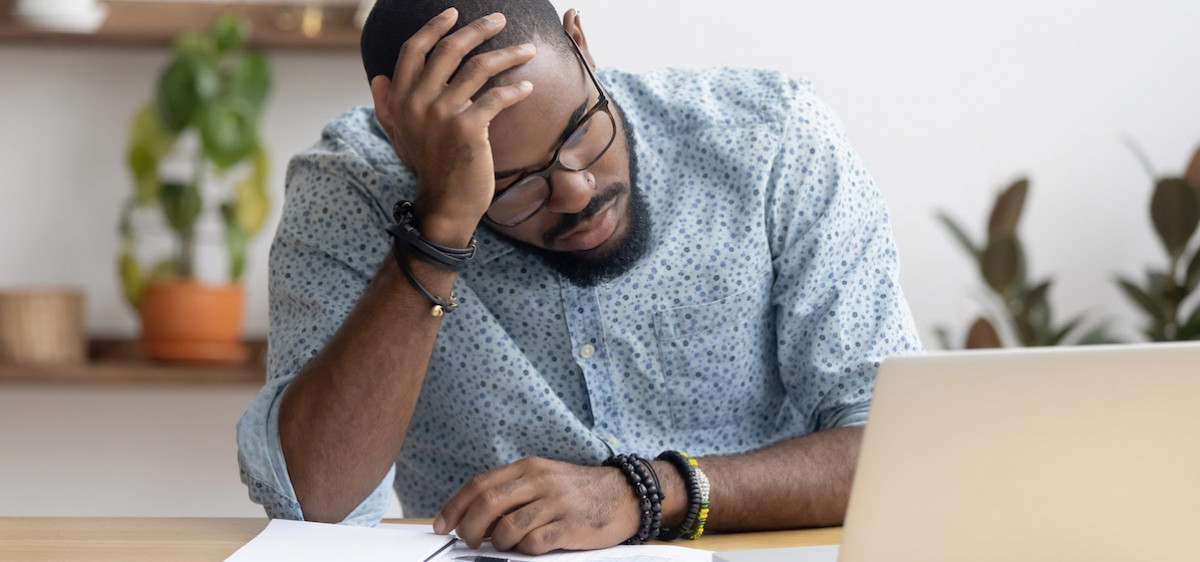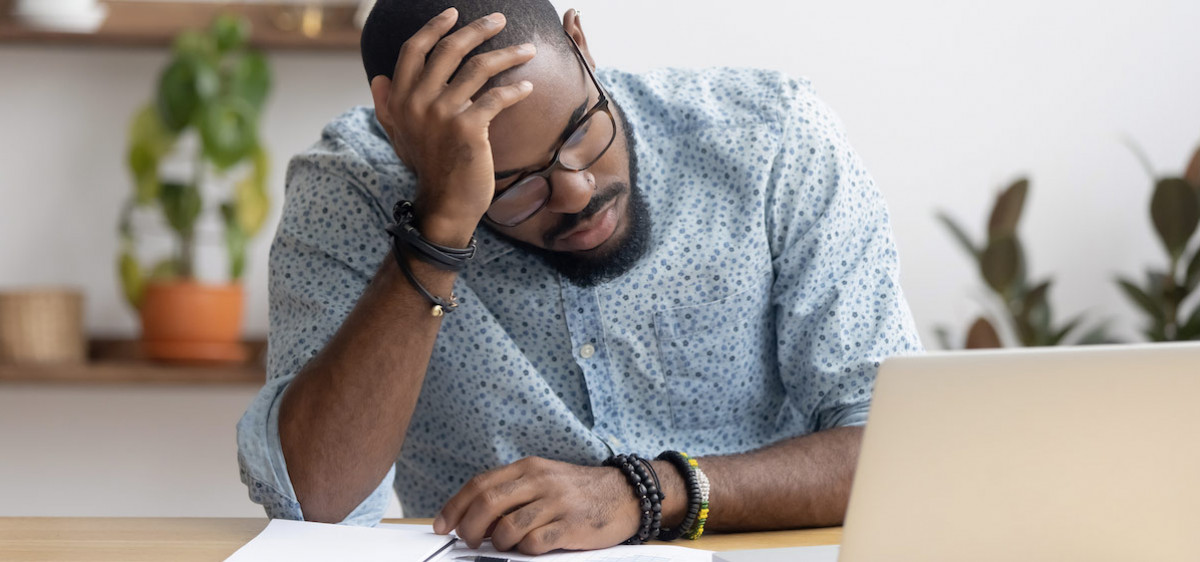1 Les féculents font-ils grossir ?
Réponse : FAUX. Les féculents contribuent à votre équilibre alimentaire et à vous maintenir en bonne santé. Ils apportent de l’énergie à votre organisme, qu’il va dépenser progressivement toute la journée, et permettent d’éviter les coups de pompe et les fringales.
« Pour optimiser les bénéfices santé des féculents, privilégiez les féculents complets. Ils seront plus riches en fibres qui contribuent à la satiété et à un bon fonctionnement du système digestif, indique Nathalie Hutter-Lardeau, nutritionniste. Attention, quand les féculents sont consommés en excès, au-delà des besoins de l’organisme, le corps peut alors choisir de garder cette énergie en réserve et cela pourra alors vous faire prendre du poids. »
Faites également attention à la manière dont vous préparez vos plats. Ce ne sont pas tant les féculents qui font grossir mais les sauces, le beurre ou le fromage que vous y ajoutez. À consommer avec modération donc !
Bon à savoir
Pain complet, pâtes, riz, pommes de terre… Vous pouvez manger des féculents à chaque repas, mais en quantité modérée. Ils doivent représenter au maximum environ un quart de votre assiette. Un bon morceau de pain peut suffire par exemple.
2 Le lait fait-il grandir ?
Réponse : VRAI. Lorsqu’un nourrisson naît, le lait maternel (ou le lait en poudre) lui fournit tous les apports nutritionnels nécessaires à sa croissance, les premiers mois de sa vie. Puis, votre enfant a besoin d’une alimentation diversifiée et équilibré, car d’autres éléments sont indispensables à son bon développement.
« Le lait contribue à la croissance de votre enfant grâce à ses apports en calcium, protéines, sucre et graisses, indique la nutritionniste. Il est essentiel jusqu’à l’adolescence. Pour fixer le calcium, nécessaire au développement des os, il faut aussi de la vitamine D que l’on trouve dans certains aliments comme les poissons gras (thon, saumon, etc.) et en s’exposant au soleil. »
3 Le poisson est-il bon pour la mémoire ?
Réponse : VRAI. Le poisson contient des éléments favorables au bon fonctionnement cérébral : les oméga 3.
« De nombreuses études mettent en lien la consommation d’oméga 3 et la prévention des troubles du cerveau, souligne la nutritionniste. Il a été observé une meilleure mémoire chez les personnes ayant une alimentation riche en oméga 3. Ce sont surtout les poissons dits “gras” qui en contiennent : sardine, maquereau, hareng, truite, saumon… », précise Nathalie Hutter-Lardeau.
4 Le sel est-il mauvais pour la santé ?
Réponse : VRAI et FAUX. Le sodium contenu dans le sel est nécessaire au bon fonctionnement de votre corps. Il maintient les bonnes quantités de liquide dans l’organisme et il est essentiel au fonctionnement nerveux et musculaire. Il est recommandé de limiter votre consommation de sel à moins de 5 grammes par jour pour un adulte. Pour cela, pensez à lire les étiquettes de vos produits avant consommation.
« L’excès de sel est mauvais pour la santé, car il perturbe l’équilibre des organes. Il peut causer notamment de l’hypertension. Avec l’âge ou dans le cas de certaines pathologies, ces mécanismes de régulation fonctionnent moins bien, il faut alors suivre un régime pauvre en sel ou sans sel », explique la nutritionniste.
5 Faut-il préférer la viande blanche à la viande rouge ?
Réponse : VRAI. Les études scientifiques montrent qu’une consommation trop importante de viande rouge est liée à un risque plus élevé de développer certains cancers. Il est recommandé de limiter sa consommation de viande à 500 g par semaine, ce qui représente environ 3 à 4 steaks. Privilégiez donc la viande blanche, moins nocive pour l’organisme.
Le saviez-vous ?
« La viande, le poisson et les œufs sont à considérer comme un composant du plat principal et non comme l’élément dominant. Ils doivent donc être consommés en quantité inférieure à celle de l’accompagnement : légumes et/ou féculents. Pour varier les plaisirs, pensez à alterner la viande, la volaille, le poisson, les œufs et les légumes secs dans vos repas de la semaine », conseille Nathalie Hutter-Lardeau.
6 L’huile est-elle moins grasse que le beurre ?
Réponse : FAUX. Le beurre est composé de graisse (environ 80 %) et d’eau, tandis que l’huile est composée uniquement de graisse (100 %).
« Les deux sont intéressants pour la santé. Consommer cru (en quantité raisonnable bien sûr, soit environ 10 g par jour) le beurre contient de la vitamine A, bonne pour la vue, indique la nutritionniste. Privilégiez les huiles riches en oméga 3 (colza, noix, olive), particulièrement bénéfiques au système cardiovasculaire et au cerveau. »
Vous souhaitez manger plus équilibré au quotidien ?
Le contrat Garantie Santé de la Macif vous couvre en cas de consultation chez un nutritionniste*.
*Voir conditions du contrat
Découvrez les autres résultats du test