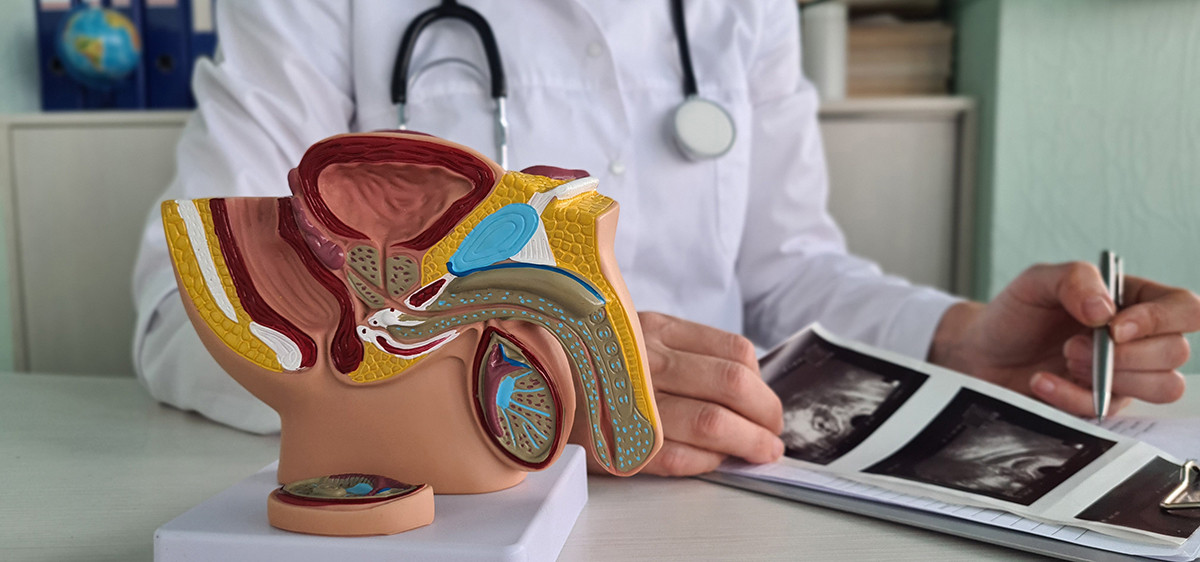Radia Djebbar : Faux ! C’est peut-être la fausse croyance la plus répandue, qu’il est important de déconstruire. Être atteint du VIH ne signifie pas avoir le sida. Le VIH est un virus pouvant entraîner le Sida. Si le VIH n’est pas traité, il peut affaiblir le système immunitaire jusqu’à atteindre le stade Sida, mais aujourd’hui, grâce aux traitements Sida, de nombreuses personnes vivent avec le VIH sans jamais développer le Sida.
« On peut attraper le VIH par simple contact physique »
R.D. : Faux. Après 40 ans de VIH, on se bat toujours contre ces idées, qui sont en réalité des peurs irrationnelles. Les toilettes publiques ou le sang séché sont encore, à tort, une hantise pour les gens. Le partage de couverts, les poignées de porte, les câlins, les baisers, dormir dans le même lit, boire dans la même canette… Tout cela comporte un risque nul de transmettre le VIH. Les vrais risques de contamination sont les suivants : des rapports sexuels non protégés, le partage de seringues ou d’aiguilles en cas de consommation de drogue par voie intraveineuse, et la transmission verticale de la mère à l’enfant.
« Les femmes séropositives ne peuvent pas avoir d’enfants sans les infecter »
R.D. : C’est compliqué. Le désir d’enfant est tout à fait réalisable pour une personne vivant avec le VIH. Cependant, il est essentiel de planifier la grossesse afin de bénéficier d’un suivi médical adapté et de minimiser le risque de transmission du virus à l’enfant. En France métropolitaine, les traitements antirétroviraux ont permis de réduire le taux de transmission mère-enfant du VIH-1 à 0,54 % entre 2005 et 2011, contre 15 à 20 % sans traitement.
« Aucun risque d’attraper le sida en pratiquant du sexe oral »
R.D. : Faux. Pratiquer une fellation avec une personne non traitée, tout comme les relations sexuelles entre femmes, présente un risque faible, mais réel, surtout en cas de présence d’infections sexuellement transmissibles ou de lésions sur les muqueuses.
« On ne peut pas contracter le VIH en ayant un seul partenaire sexuel »
R.D. : Avoir un seul partenaire tout au long de sa vie n’assure pas une protection contre le VIH. Si l’un des partenaires est infecté, il peut transmettre le virus lors de rapports non protégés. La fidélité mutuelle n’est une méthode de prévention efficace que si les deux partenaires sont séronégatifs et le demeurent. Pour que cette démarche soit réellement protectrice, les deux partenaires doivent en premier lieu se faire tester.
« Le Sida, on n’en meurt plus »
R.D. : C’est compliqué. Il est important de distinguer deux phases dans l’évolution de la maladie : l’infection par le VIH et le Sida, qui représente le stade avancé de l’infection. Dans les années 1980, lorsque les dispositifs d’accompagnement ont été mis en place, ils visaient principalement à accompagner les malades en fin de vie. Aujourd’hui, grâce aux traitements, une personne séropositive avec une bonne immunité peut avoir une espérance de vie comparable à celle d’une personne non infectée. Selon les prévisions de l’OMS, si toutes les personnes vivant avec le VIH étaient dépistées et traitées, il serait possible d’éliminer les nouvelles contaminations d’ici 2030.
« Le préservatif est efficace à 100 % pour se protéger du VIH »
R.D. : Au-delà du préservatif, essentiel, il existe d’autres méthodes de prévention du VIH en complément ou en alternative au préservatif. Parmi elles, la PrEP (prophylaxie préexposition), un traitement préventif destiné aux personnes ne souhaitant pas utiliser de préservatif. Il y a également le TPE (traitement post-exposition), administré aux personnes ayant pris un risque, comme lors d’un rapport non protégé. Ce traitement doit être initié dans les 48 heures suivant l’exposition. À noter : ces traitements sont entièrement pris en charge, y compris pour les personnes sans complémentaire santé.
« C’est compliqué de se faire dépister »
R.D. : C’est faux. Il existe au moins un Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (Cegidd) dans chaque département, dont la liste est accessible sur le site vih.org. Il est également possible de réaliser un dépistage dans un laboratoire d’analyse médicale, sans avoir besoin de rendez-vous, d’ordonnance ou d’avancer des frais. Une autre option consiste à utiliser un autotest, disponible en pharmacie pour un prix compris entre 25 et 30 €. Les délais pour détecter une éventuelle infection varient en fonction des tests, allant de six semaines à trois mois après l’exposition au risque.
« On peut être guéri du VIH »
R.D. : Faux. À ce jour, il n’existe pas de remède ni de vaccin pour guérir le VIH. Cependant, les traitements antirétroviraux permettent de contrôler le virus et de vivre sans symptômes, avec une espérance de vie quasi similaire à une personne non porteuse du VIH. Comme le VIH peut rester asymptomatique pendant plusieurs années, se faire dépister est indispensable. Par ailleurs, des avancées significatives dans la recherche vaccinale sont en cours, et des essais cliniques prometteurs ont été réalisés.
Consultations médecin généraliste, gynécologue, urologue
Découvrez Macif Mutuelle Santé, une complémentaire qui s’adapte à vos besoins