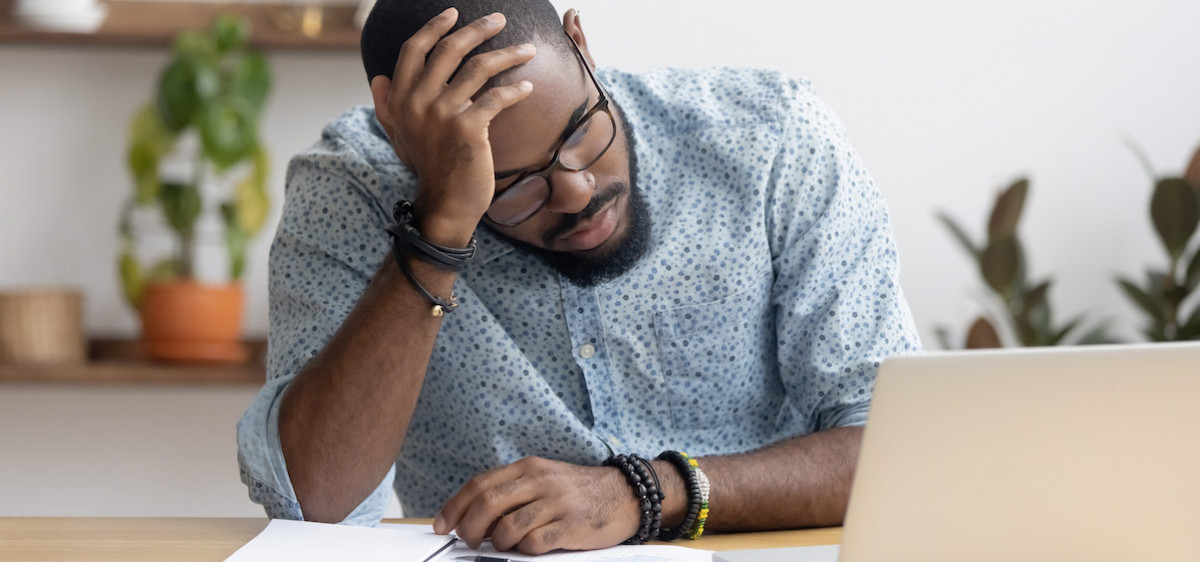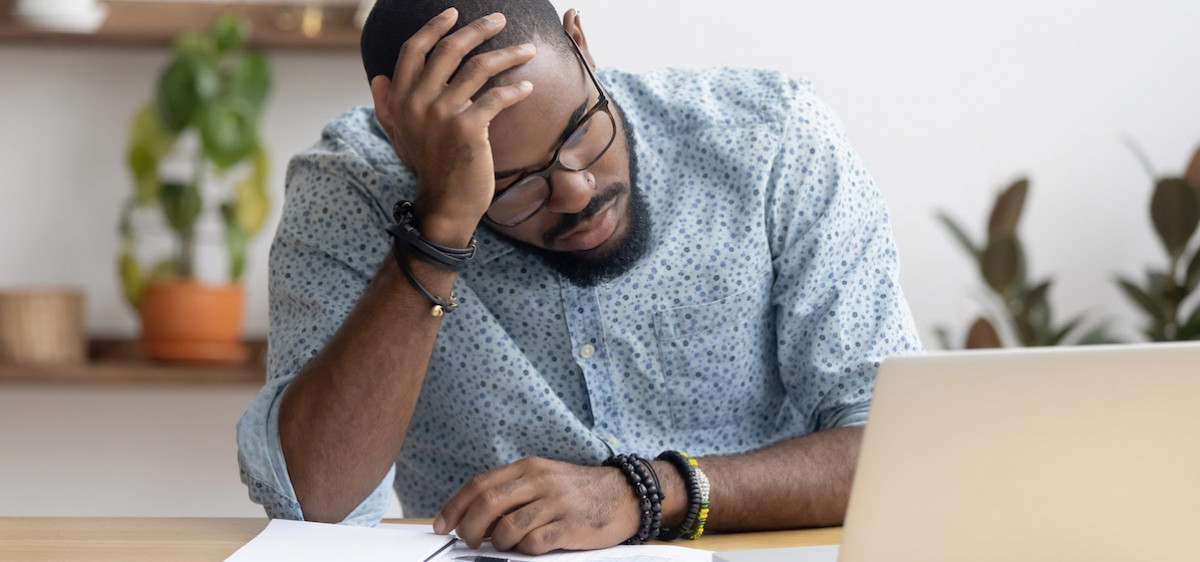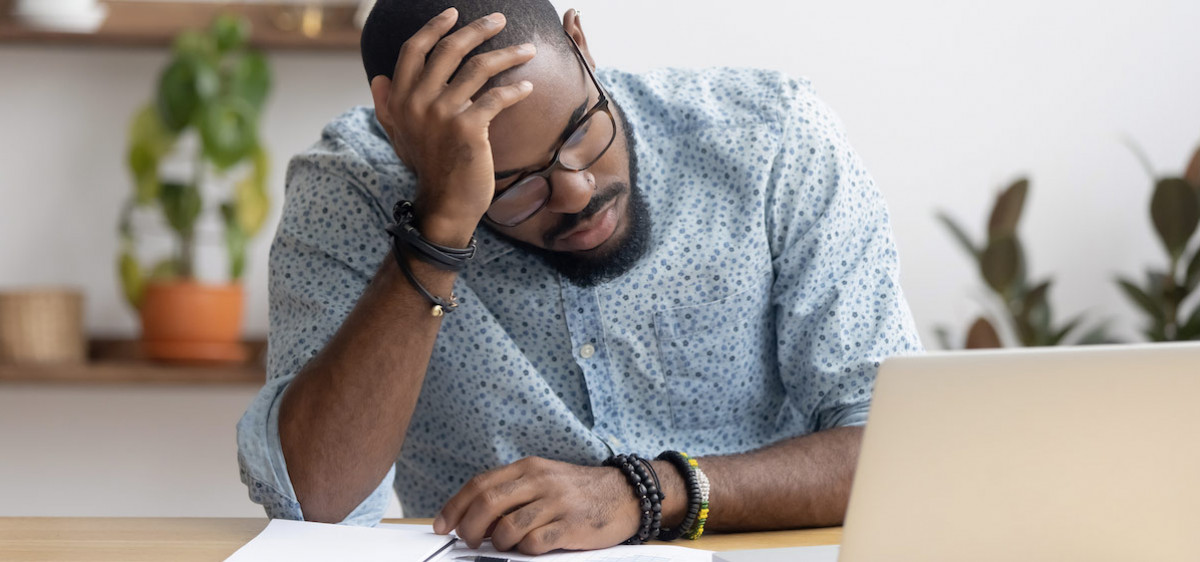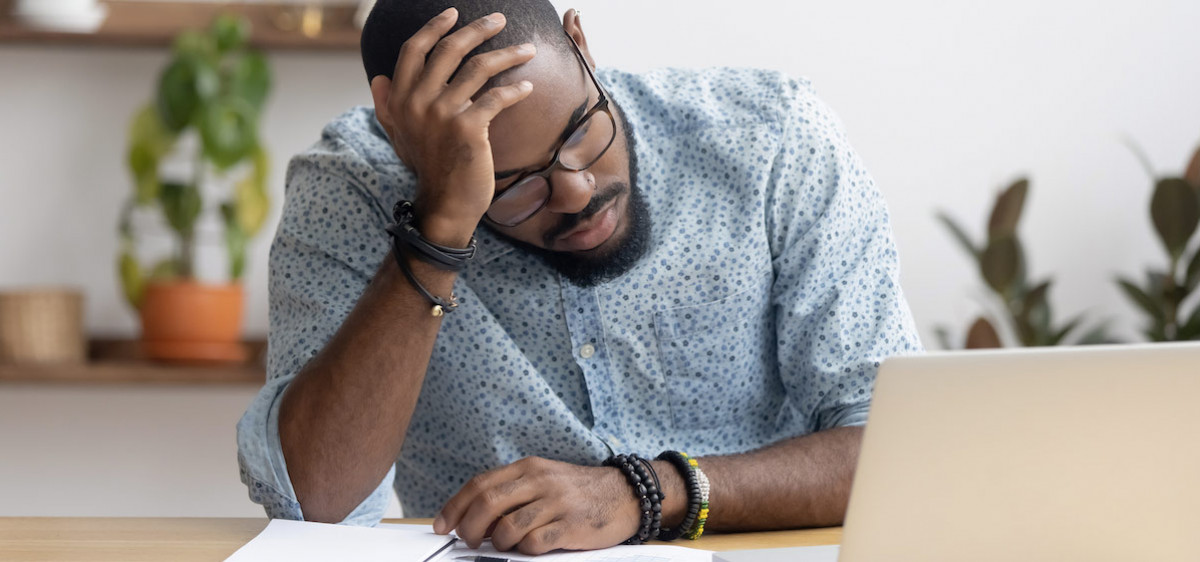Bonjour Nordine. Tu t’apprêtes à monter sur scène : est-ce que, malgré l’habitude, tu as toujours le trac ?
Ouais, quand même ! On a toujours peur, surtout quand c’est filmé, on veut toujours faire des trucs bien, avoir un bon mood et tout, donc je pense que ça va être bien. Après, pour De Ouf !, j’ai un thème assez précis, donc, tu vois, on essaie de s’y tenir et de respecter. Ne pas être vulgaire, être bienveillant… Et si on s’égare un peu du thème, les gens, ils vont pas nous taper dessus, quoi !
Ton métier, c’est de faire rire les gens. D’où te vient “ce truc”, est-ce que c’était déjà le cas quand tu étais enfant ?
Je pense que j’ai toujours voulu être le gars qui fait golri les gens, mais ça n’a jamais été par des blagues. Avant, c’était plus en me faisant remarquer. J’étais un petit élève turbulent, tu vois, je faisais des bêtises à l’école pour faire marrer la galerie. Après, j’ai capté que je voulais vraiment faire un métier à part, donc j’ai commencé à chercher un peu, je voulais être dans le foot à fond. Mais j’ai arrêté et je me suis lancé dans tout ce qui est comédie, et puis j’ai commencé à faire du stand-up très vite. À 17 ans, j’ai démarré, j’ai quitté Bordeaux pour Paris. Aujourd’hui, c’est mon job à temps plein, donc c’est cool, de ouf.
Tu as fait salle comble partout avec ton spectacle “Ultra Violet” : qu’est-ce qu’on se dit quand on a rempli autant de salles, quand on a fait rire autant de gens ?
Il y a un double sentiment, il y a un truc de “p***** c’est fini” ! En même temps, t’es fier, et en même temps, t’as peur, parce que le plus important, c’est la suite. Et c’est un truc qui te torture en vrai au quotidien. Moi je pense toujours à l’après et en même temps il faut penser à ce que t’as maintenant. Il ne faut pas penser à demain, parce que quand on démarre, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le problème c’est que quand t’as du succès, tu sais qu’il y a un demain. Donc du coup, le demain, il faut le préparer pendant que t’es dans le présent, et c’est ça le plus dur, tu vois. Donc franchement j’ai hâte de préparer la suite, mais je suis confiant, déjà “Violet” ça a été une belle aventure ! En vrai, ce spectacle-là, c’est une consécration de malade, genre, j’aurais jamais imaginé faire tout ça. Maintenant, le but, c’est de se dire, on a fini ça en beauté et on passe à la suite.
Tu es donc déjà en cours de travail pour la suite ?
Ouais, j’ai repris le chemin des comédies-clubs, au Sacré, au Paname, au Jamel Comédie-Club… pour essayer déjà de me remettre dans cette direction, et une fois qu’on aura tout écrit, tout travaillé, on pourra se relancer sur la suite.
Est-ce que tu as conscience d’aider les gens à poser un autre regard sur eux, à mieux accepter leur fragilité, leur vulnérabilité ? Est-ce que l’humour, ça sert aussi à ça ?
J’ai pas forcément écrit en ayant ça en tête, mais c’est vrai que plus j’avance et plus je reçois des messages de gens qui me disent “merci pour ton regard, merci pour ce que tu racontes, parce que ça me touche” donc ça me fait plaisir. Après, l’idée, c’est vraiment d’être honnête avec moi-même, ce que je fais, c’est vraiment dans l’idée de me ressembler moi, et de faire un truc qui me correspond. Et ça touche les gens, donc c’est cool. Parce que oui, faire rire, ça permet de décloisonner beaucoup de choses, ça dédramatise des sujets lourds, et rire, ça permet aux gens d’être bien dans leur tête, dans leur peau. C’est incroyable et je conseille à tout le monde de rigoler parce que c’est la meilleure façon d’aller mieux quand on ne va pas bien !
Et le choix du violet, pour le nom du spectacle, dans la tenue, c’est pour quoi ?
En fait, il y avait d’abord cette histoire de mélange. Parce que moi je suis métis : mon père est congolais, ma mère est marocaine-algérienne et je voulais trouver une façon subtile de parler de ça, sans dire je suis arabe et noir quoi. Donc je trouvais que le fait de prendre une couleur comme le violet c’était intéressant. Après, il y a aussi toutes les valeurs que le violet incarne : le symbole du féminisme, la douceur, l’apaisement ; et c’est même devenu une sorte d’état d’esprit aujourd’hui, donc c’est cool. Il y a même des gens qui viennent habillés en violet dans ma salle.
Tu participes à la saison 3 de De Ouf ! : est-ce que tu connais les autres humoristes qui partagent la scène avec toi ?
Oui, on se connaît tous, c’est bienveillant, on rigole entre nous, on se donne des retours sur des blagues. On est vraiment une bonne équipe. Et surtout, ce ne sont que des gens que j’aime bien. Moi, je suis quelqu’un de très généreux, très solaire, j’ai beaucoup de respect pour tout le monde, donc en vrai c’est cool et là, ça a été une très bonne soirée.
On se prépare différemment quand le public ne vient pas pour soi, ou ne connaît pas forcément l’artiste, comme c’est le cas dans un programme de stand up comme De Ouf ! ?
Ouais, on sait jamais vraiment, en fait il faut travailler les blagues au max et voir comment ça réagit. Si le public réagit bien, tant mieux, et si ça réagit pas, c’est que c’est que c’était pas pour nous et il faut se remettre en question mais généralement quand tu fais ton passage en plateau en comédie club, c’est beaucoup plus dur que dans des émissions de télé, là, il y a un chauffeur de salle, il y a quelqu’un qui vient mettre une énergie donc c’est plus simple d’arriver avec des blagues qui marchent, donc c’est cool.
Quel petit conseil tu donnerais aux jeunes qui voudraient se lancer dans le stand up ?
Mon conseil, c’est : faites des blagues, écrivez, testez-les dans les comédies club et surtout gardez en tête que c’est en étant toi-même que tu vas faire des grandes choses. Plus tu restes toi-même et plus tu vas être dans une direction qui t’appartient.
De Ouf ! par Macif : revivez la saison 3 !
Meryem Benoua, Ethan Lallouz, Nordine Ganso, Laurie Peret, Sofiane Soch, Rodrigue, Nordine Ganso : retrouvez la team 2025 sur la scène du Sacré dans la saison 3 de De Ouf ! par Macif, présentée par Camille Lellouche.