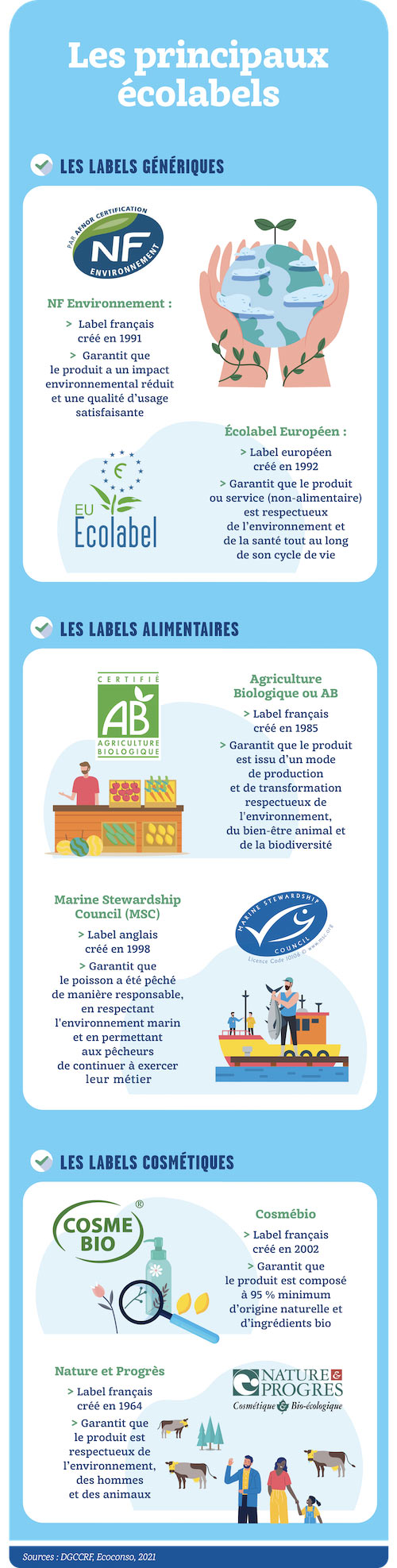Noël sans viande et sans poisson
Dans ce contexte, les fêtes de Noël peuvent rapidement devenir le cauchemar des Français ayant opté pour ce régime alimentaire. D’autant plus qu’il suscite encore trop d’interrogations, voire de moqueries. Entre les questions des grands-parents perplexes, les suggestions d’un proche un peu lourd, être végétarien au moment des fêtes de fin d’année demeure pour beaucoup un parcours du combattant. Anna, 25 ans, est végétarienne depuis 2018. À l’époque, elle a dû répondre à une ribambelle de questions quant à sa conversion : « Les premiers Noëls, c’était “Ah ! Tu ne manges pas non plus de noix de Saint-Jacques ? T’es sûre que tu ne veux pas de saumon ? Pourquoi t’es végétarienne ?”. » Des interrogations, que Paul, 35 ans, a aussi affrontées. Onze ans après qu’il soit devenu veggie, on continue de passer les plats de volaille à ce professeur des écoles, qui vient d’une famille où la viande est sacrée : « Dans ma famille, on continue à m’en proposer par gentillesse, mais bon… Les gens ne comprennent pas forcément que le poulet c’est bien de la viande. »
Stratégie fromage dessert
Quand il s’agit du menu de Noël, Paul a ses petites astuces : « Pour l’apéritif, il y a toujours une ribambelle de petits fours et de bonnes choses que je peux manger », explique ce natif du Loir-et-Cher qui, bien que végétarien, apprécie tout de même les huîtres. Ensuite, alors que la plupart des convives se ruent sur le plat, lui préfère se concentrer sur la suite : « Le soir de Noël, je ne prépare pas grand-chose de spécial parce que je sais que le plateau de fromages est toujours incroyable et que les autres convives ont souvent déjà trop mangé pour en profiter. Quand personne n’a plus de place, je me régale avec le fromage et les desserts », s’amuse Paul. Une stratégie validée par Anna, aussi adepte du plateau de fromages. Il n’empêche qu’il est parfois frustrant de passer à côté de l’aspect festif des plats de viande et de poisson dégustés par tous : « Au moment du plat, je dois reconnaître qu’il y a une frustration, je me souviens qu’une année ma grand-mère avait fait l’effort de m’acheter de bonnes pâtes fraîches sur le marché, c’était sympa, mais au final, j’ai mangé des pâtes, ça n’est pas franchement l’image qu’on se fait du repas de Noël », se souvient la jeune femme. Pour s’offrir ce côté festif, Paul a un grand allié : la truffe, qu’il aime notamment pour son côté exceptionnel et qui se décline dans de nombreuses préparations présentes en grande surface (fromage, purée, tartinade pour l’apéritif). Il y a quelques années, le professeur s’est même essayé à la confection d’un foie gras végétarien, à base de champignons et de pois chiches pour un résultat mi-figue mi-raisin : « Visuellement, ça rendait super bien, mais objectivement, ça n’était pas super bon. Je n’ai pas renouvelé l’expérience. »
L’alternative végétarienne
Cette année, Paul préparera sans doute un velouté de topinambour « pour une entrée chaude et réconfortante », puis son fameux crumble de légumes de saison, à base de patate douce, oignon, carotte, butternut et parmesan, qui fait toujours son petit effet. Anna pense, elle, avoir trouvé la recette parfaite pour réussir son réveillon. Cette journaliste a découvert il y a peu, dans une épicerie végane à Paris, un filet mignon de viande végétale à la texture incroyable. Pour Noël, elle a prévu d’en commander pour le cuisiner avec une petite sauce moutarde, des champignons et des carottes. « Ce qui est sympa, c’est que je vais pouvoir manger “comme eux”, raconte la jeune femme, qui constate que, depuis ses débuts en tant que végétarienne, les choses ont beaucoup changé. Aujourd’hui il y a des alternatives à la viande qui sont vraiment bluffantes. À chaque fois, mes proches veulent goûter. Il y a cinq ans, ça n’était pas le cas. » Une tendance qui accompagne un vrai changement sociétal, car, si la population française demeure en proportion peu nombreuse à adopter un régime végétarien, les jeunes vont faire bouger les lignes. 12 % des 18-23 ans se disent végétariens. Paul l’a constaté. Après s’être senti bien seul dans sa famille durant des années, il a vu son petit frère puis sa cousine tenter l’expérience. Qui sait, dans cinquante ans, ce sont peut-être ceux qui mangent de la viande qui seront soumis aux questions de leur famille ?