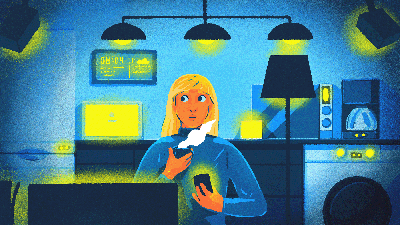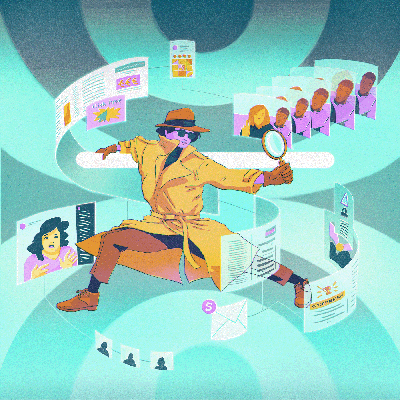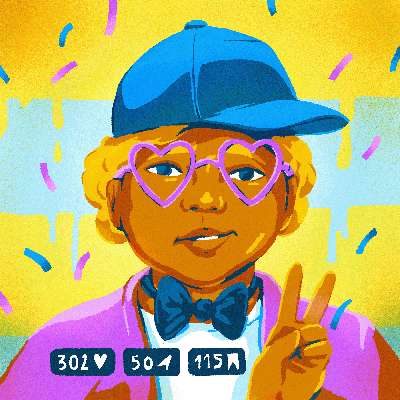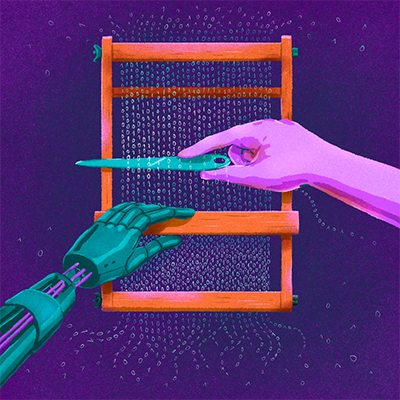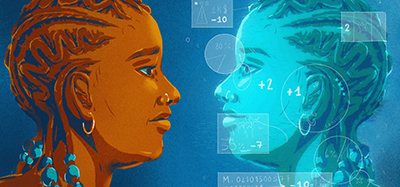Maîtriser la natation pour un enfant, c’est non seulement s’amuser, mais aussi acquérir des réflexes de sécurité pour réduire le risque de noyade, qui a causé 361 décès à l’été 2023. Voici comment accompagner votre enfant dans cette aventure aquatique, avec les témoignages de parents et les conseils de professionnels.
À quel âge un enfant peut-il apprendre à nager ?
Les experts recommandent de mettre les enfants à l’eau dès le plus jeune âge. Les bébés peuvent d’ailleurs débuter des cours d’éveil aquatique ou bébé gym dès 4 mois, ce qui les aide à se familiariser avec l’eau dans un environnement sécurisé et ludique. Cependant, pour des cours de natation plus structurés, l’âge de 6 ans est idéal : c’est là que les enfants développent une meilleure coordination motrice et une maturité émotionnelle qui leur permettent d’apprendre les techniques de base.
Peut-on enseigner soi-même à son enfant ?
De nombreux parents choisissent d’enseigner eux-mêmes la natation à leurs enfants. Cette approche présente plusieurs avantages, comme la possibilité de renforcer la relation de confiance et aussi de bénéficier d’une grande flexibilité dans les horaires. Mais pour un apprentissage optimal, le mieux est de combiner enseignement parental et cours de natation avec des professionnels. Les conseils de maîtres-nageurs restent très importants, les parents pouvant parfois manquer de bagage technique pour apprendre les bons gestes et de connaissances en matière de sécurité. Ainsi, Claire, maman de Léa : « J’ai commencé à familiariser ma fille avec l’eau dès l’âge de 6 mois en jouant avec elle à la piscine municipale. Aujourd’hui, à 4 ans, elle adore nager et se sent très à l’aise dans l’eau. Mais elle ne maîtrise pas parfaitement les gestes de la brasse, et je pense quand même lui prendre quelques cours cet été. » Pour Sophie, maître-nageur, chaque enfant est différent : « Certains peuvent être prêts à apprendre les techniques de base dès 3 ans, tandis que d’autres peuvent prendre un peu plus de temps. Si vous voulez familiariser votre enfant à la nage, vous pouvez faire des exercices avec lui dans l’eau, à condition de ne pas le mettre tout le temps dans la même situation. Il faut multiplier les situations pédagogiques pour enrichir son expérience dans l’eau. L’important est de ne pas les forcer et de rendre l’apprentissage amusant. » Marc, papa de Tom, 5 ans, témoigne : « Nous avons pris des cours de natation ensemble avec mon fils, ce qui nous a permis de passer du temps de qualité tout en apprenant. Le maître-nageur a vraiment su le rassurer et lui donner confiance. Et de mon côté, j’ai aussi appris 2/3 trucs utiles ! »
Dans certains établissements scolaires, notamment en Seine-Saint-Denis, département dans lequel un enfant sur deux ne sait pas nager à son entrée au collège, il existe aussi une réelle politique d’apprentissage de la nage : à Romainville par exemple, des séances de natation – environ une dizaine – sont organisées à la piscine municipale dès la grande section de maternelle. L’apprentissage de la natation est enrichissant pour les enfants comme pour les parents. C’est une véritable étape dans leur développement. Commencez dès que possible, respectez leur rythme et combinez l’enseignement parental avec des cours professionnels pour garantir une expérience autant sécurisée qu’agréable. Et rappelez-vous, la patience et la persévérance sont les clés du succès.
Quelques conseils pratiques pour les parents
- Mettez des brassards adaptés à la taille de l’enfant et conformes à la norme NF
- Baignez-vous dans des zones surveillées
- Tout d’abord, familiarisez votre enfant avec l’eau à travers des jeux simples et amusants.
- Progressez en douceur, sans jamais le forcer.
- Enseignez-lui les techniques de base, comme flotter sur le dos, une compétence essentielle pour la sécurité, mais aussi les coups de pied simples et les mouvements de bras basiques.
- Surveillez constamment votre enfant lorsqu’il est dans l’eau, même s’il porte des brassards.
- Apprenez-lui les règles de sécurité aquatique, comme ne jamais nager seul.
Quelques exercices à faire avec son enfant pour lui apprendre à nager
- Mettre la tête sous l’eau
- Passer sous l’eau entre vos jambes
- Faire la planche
- Se propulser dans l’eau sur le bord de la piscine, en prenant appui sur ses pieds
- Utiliser une planche pour qu’il s’exerce à battre des pieds
- Utiliser des palmes