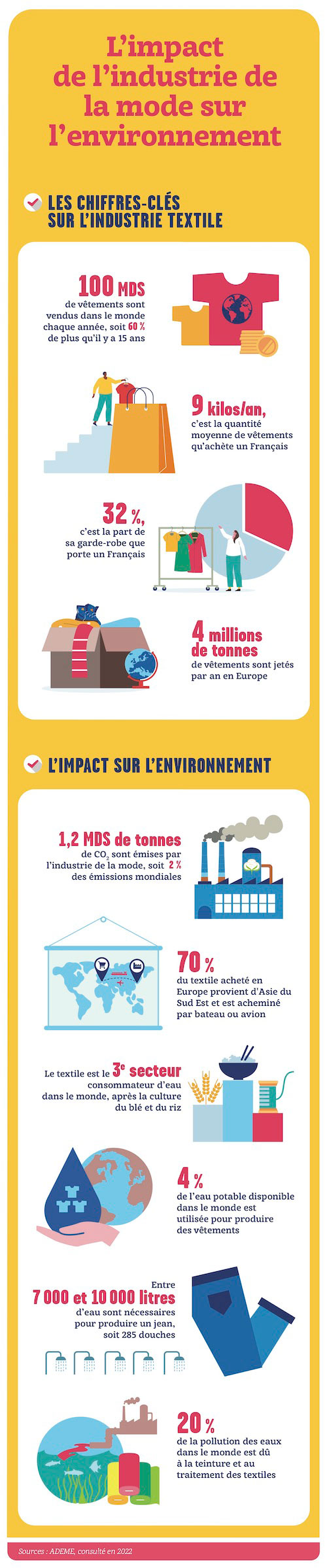En 2023, 13 millions de Français de 16 ans ou plus se déclarent bénévoles, soit environ un quart de la population. Piliers du tissu associatif, 86 % des 1 300 000 associations actives en France sont animées exclusivement par des bénévoles. Selon les chiffres clés de la vie associative 2023, recueillis par l’Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation populaire (INJEP), le domaine sportif représente près d’un tiers du volume de travail bénévole, suivi des domaines de défense de causes, action sociale, humanitaire et caritative.
Bénévolat : pour qui, pourquoi ?
En dehors d’un bienfait intime et personnel, l’engagement bénévole permet des avancées concrètes. À commencer par la prise de conscience d’une réalité sociale chez les plus jeunes. « Les maraudes que j’effectue avec la paroisse Saint Vincent de Paul dans le quartier de Montparnasse à Paris m’ont permis de démystifier les invisibles que sont les sans-abri », confie Julie Gallys, 23 ans, juriste en alternance dans le secteur de l’énergie. Son engagement bénévole commence quand elle arrive dans la capitale pour ses études. La jeune fille réalise, hallucinée, que la « précarité est partout », des rues aux universités. Dès ses premiers mois en tant qu’étudiante, elle-même doit avoir recours aux distributions alimentaires organisées par Linkee, une association de lutte contre le gaspillage alimentaire et qui redistribue aux étudiants précaires.
- Lire aussi : La précarité étudiante aggravée par la crise
Une pensée la traverse lors des récupérations de panier : « C’est en donnant que l’on reçoit. » Julie devient alors bénéficiaire et bénévole de l’association. « J’ai vu concrètement qu’un petit geste pour nous peut avoir de grandes conséquences sur les autres. Et ça nous fait regarder plus loin que nos propres vies », continue-t-elle. En France, les femmes participent plus régulièrement que les hommes à la vie associative, elles représentent 52 % des bénévoles.
Reprise du bénévolat chez les jeunes
bénévolat associatif chez les plus jeunes en 2023. « Il y a chez eux une envie d’engagement qui ne cesse de progresser ces dernières années, avec souvent l’idée de faire avancer les choses de manière concrète et à leur échelle dans un monde si incertain, où le politique leur semble trop éloigné de leurs préoccupations », analyse Pascal Dreyer, vice-président Recherches & solidarités dans le rapport IFOP sur l’engagement bénévole en 2023. Créé au Québec en 2002, le concept des Accorderies a été introduit en France sous l’égide de la Fondation Macif et du Secours catholique en 2011. Fondées sur un système d’échange de services utilisant une « monnaie temps », elles sont la preuve qu’un engagement bénévole, basé sur le don de son temps et ses compétences, permet des gains sociaux mesurables. Parmi eux, la mixité sociale. À l’Accorderie d’Hayange, en Moselle, se croisent des individus de différents âges, situations sociales, nationalités et genres. Conversations en italien, cuisine, tricot ou encore réparation de voiture, il y en a pour tous les goûts. Ces lieux peuvent également être un levier concret dans la recherche d’emploi. « Ici, tu rencontres quelqu’un qui te fait rencontrer quelqu’un d’autre, et ainsi de suite. Cela m’a aidé à retrouver un emploi en recontactant tous mes anciens patrons et collègues », raconte Pascal, 44 ans, accordeur à Chambéry.
La gratuité a un prix
De manière générale, Accorderies ou autres associations solidaires posent les bases d’une citoyenneté active, invitant à l’action concrète, source de confiance en soi, et aux autres. « Il y a également une notion de partage dans l’associatif. On noue des liens avec les autres bénévoles, que l’on revoit chaque semaine, tous les mois, on devient riches des rencontres que l’on fait », confirme l’étudiante Julie Gallys.
Malheureusement, le bénévolat associatif diminue depuis 2010, surtout chez les plus âgés. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution. « Ces personnes occupent souvent une position pivot entre plusieurs générations qui demandent leur soutien et peuvent les accaparer : leurs parents, leurs enfants et leurs petits-enfants. Par ailleurs, les baby-boomers n’ont pas connu la Seconde Guerre mondiale, les structures d’engagement collectif qu’étaient les patronages, les églises, les associations et les syndicats. Ils ont grandi et profité de la société de consommation », contextualise Pascal Dreyer. Une tendance reste toutefois constante : plus l’on est diplômé, plus l’on s’engage. La raison est simple. Donner du temps à une association suppose d’en disposer, en plus des ressources, des compétences, et de la confiance en soi. La gratuité a un prix. En 2018, les 21 millions de participations bénévoles représentent un volume de travail de l’ordre de 587 000 emplois en équivalent temps plein.
Envie de vous engager ?
Découvrez Diffuz, le réseau des actions bénévoles de la Macif !