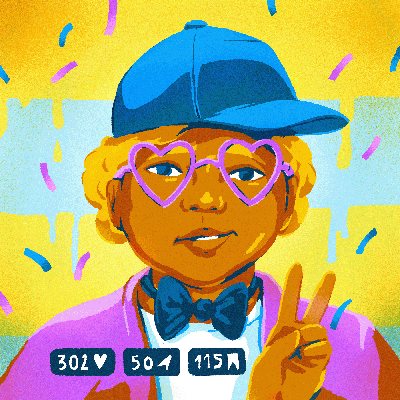Environ 1,3 million d’enfants de moins de 10 ans ont déjà consulté un médecin ORL pour des acouphènes, et pour près de 660 000 enfants, une perte auditive moyenne à sévère a été diagnostiquée. Les résultats de l’enquête Ifop-JNA 2023 sur la santé auditive des enfants sont pour le moins inquiétants, voire alarmants. Avec des conséquences à long terme, comme le précise Sébastien Leroy, porte-parole de la JNA (Journée nationale de l’audition), l’une des principales associations françaises dédiées à la santé auditive. « Le risque, c’est d’hypothéquer son capital auditif, de créer une fragilité qui déclenche des prédispositions à la perte auditive. Autrefois, on pensait que la presbyacousie (surdité liée à l’âge, ndr) était uniquement un phénomène de vieillissement. Or désormais, la moyenne d’âge de survenue des acouphènes est de 41 ans. » Selon l’Organisation mondiale de la santé, qui estime qu’une personne sur quatre devrait avoir des problèmes d’audition d’ici 2050, « plus d’un milliard de jeunes adultes risquent une déficience auditive permanente évitable à cause de leurs pratiques d’écoute non sûres ».
Limiter les écouteurs
Parmi les pratiques d’écoute non sûres, le casque ou les écouteurs, de plus en plus présents dans le quotidien des enfants et des adolescents, sont sans surprise pointés du doigt. Ainsi, selon l’enquête Ifop-JNA, 40 % des parents affirment que leur enfant écoute chaque jour de la musique via des écouteurs ou un casque d’une à quatre heures par jour. « On voit clairement un accroissement de la pratique », regrette Sébastien Leroy qui conseille d’éviter les écouteurs chez les enfants de moins de 10 ans, et qui rappelle qu’un enfant ne sait pas maîtriser le volume et ne va pas forcément dire s’il entend des sifflements ou des bourdonnements. Et tant bien même le casque disposerait d’un limiteur de volume, cela ne résout pas le problème de la durée de l’exposition au son.
- Lire aussi : 5 conseils pour protéger les jeunes oreilles
« Le problème du son, c’est à la fois son volume et son omniprésence, explique-t-il. La musique, même à faible volume, toute la journée, c’est une sollicitation permanente des cellules de l’oreille. On comprend mieux la parole en se levant qu’en se couchant, parce que l’oreille récupère durant la nuit, si on ne s’endort pas avec des écouteurs, bien sûr. Ce qui est gênant pour l’enfant, c’est qu’il y ait une réduction de son temps de récupération. Et ça va jouer sur le développement de l’apprentissage. L’oreille fait partie du cerveau, qui est mis en difficulté lorsqu’il y a une gêne auditive, un acouphène. »
Éviter les concerts avant 6 ans
Si la problématique des concerts concerne plus les adolescents et les jeunes adultes, elle n’est pas non plus à éluder pour les enfants, rappelle Angélique Duchemin, directrice d’Agi-Son, une association de prévention sonore regroupant des professionnels de la musique. « On peut faire découvrir l’univers des concerts à des enfants, mais il faut prendre des dispositions bien particulières, avec des casques antibruit. Cela dit, quand on voit des bébés dans des salles de concert ou festivals, je ne vois pas bien l’intérêt culturel. Et il faut quand même que l’enfant ait la possibilité de s’exprimer, qu’il puisse exprimer la gêne ou le mal-être potentiel qu’il ressent. Notre comité scientifique déconseille les concerts avant 6 ans, à moins qu’ils ne soient adaptés à leur âge. »
La directrice d’Agi-Son se réjouit en revanche qu’il y ait aujourd’hui « une vraie demande du public pour les protections auditives comme les bouchons en mousse », notamment sur les évènements à longue durée d’écoute comme les festivals. « Dans les discothèques, c’est malheureusement moins le cas, alors que c’est pourtant indispensable, parce qu’on y reste longtemps et que le volume ne baisse jamais. On insiste sur le fait que c’est la durée d’écoute qui va impacter fortement l’oreille, qu’il faut être à l’écoute de son corps. Si on a la sensation d’être agressé, c’est qu’il y a un problème. Il faut s’éloigner du son et ne pas écouter ses copains qui disent que ce n’est pas trop fort. Nous ne sommes pas égaux par rapport à l’audition. »
Dépister
Aux adolescents qui iraient en discothèques ou en concerts, Sébastien Leroy suggère d’offrir des bouchons réutilisables avec filtres acoustiques, « qui permettent de garder de bonnes sensations d’écoute, à la différence des bouchons en mousse ». Et d’intégrer dans leur suivi de santé un dépistage auditif. « L’ado va voir que ce sont ses oreilles, ses courbes. Parfois, on constate qu’il y a des petites encoches sur certaines fréquences qui indiquent qu’il y a déjà eu des petits traumatismes. On est sur de la prévention personnalisée, qui fonctionne vraiment bien chez les jeunes. On peut faire ces dépistages chez les audioprothésistes, c’est gratuit sur rendez-vous. » De manière plus large, il encourage les parents à intégrer dans le suivi de l’enfant « un check-up régulier de l’audition, comme pour les dents et les yeux. » En espérant être entendu.
Cinq signes qui doivent alerter
- Votre enfant vous dit qu’il a les oreilles bouchées, qu’il entend un bruit dans ses oreilles.
- Son comportement se modifie : il devient agressif, s’isole.
- Il a des difficultés d’apprentissage à l’école.
- Il se met à avoir du mal à suivre une conversation.
- Il régresse vocalement.
En cas de doute, ne pas hésiter à se rendre dans un service d’urgences ORL.
Besoin de tester votre audition ou celle de votre enfant ?
Le contrat Macif Mutuelle Santé vous accompagne en cas de consultation chez un ORL.