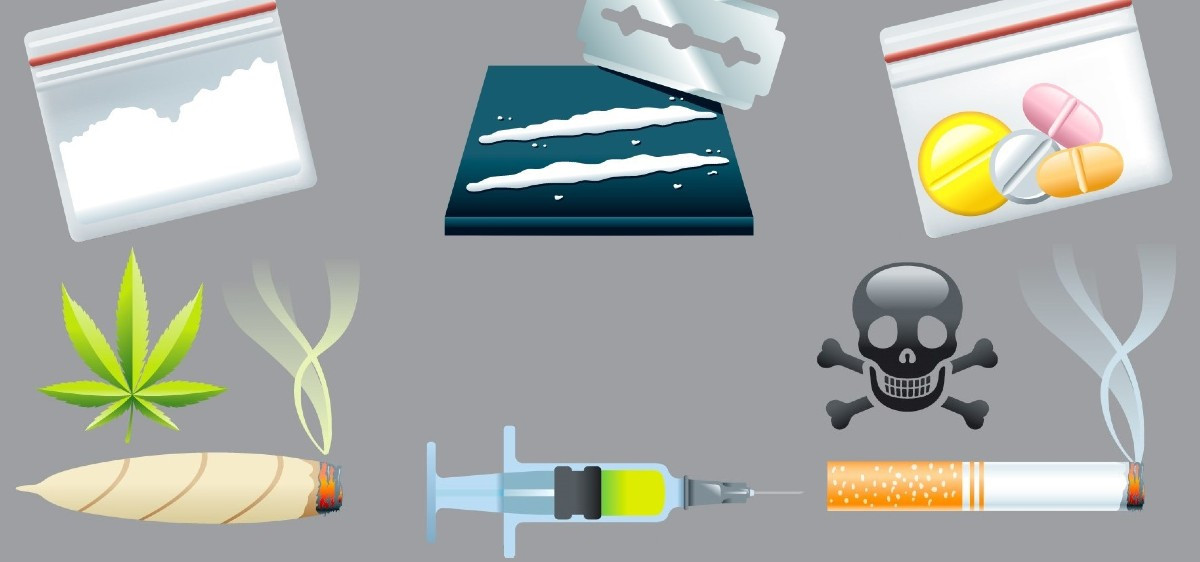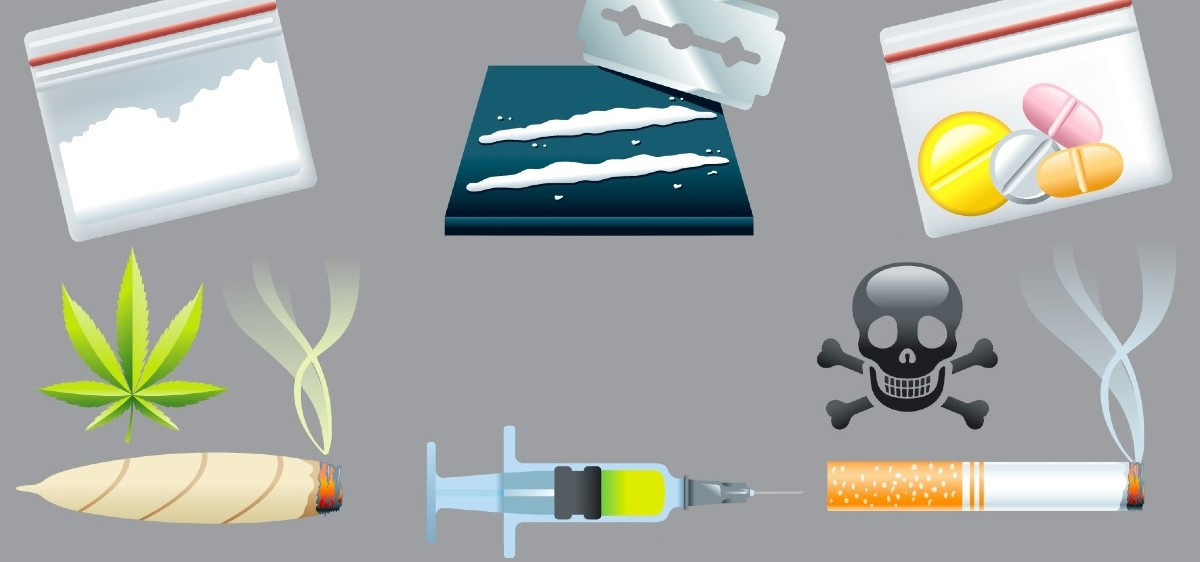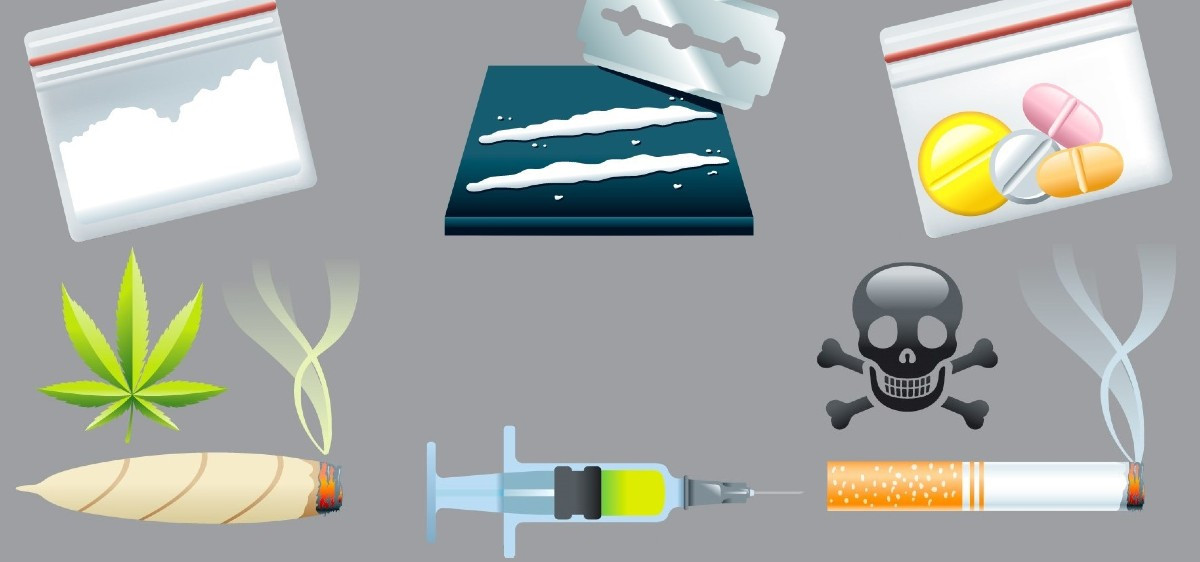1 – La prise de cocaïne provoque des crises de panique et de la paranoïa. Elle peut aussi provoquer :
- l’éclatement de vaisseaux sanguins dans le cerveau
- des convulsions et une défaillance cardiaque
- des perforations de la cloison nasale, lorsqu’elle est sniffée
Réponse : Malheureusement, toutes les conséquences indiquées peuvent être subies en prenant de la cocaïne.(1) Parmi les complications liées à une consommation régulière, on compte également des troubles de la mémoire, des difficultés à maintenir son attention et sa concentration, de l’anxiété et des épisodes de dépression.
2 – Les principaux effets du LSD consistent en des hallucinations sensorielles. Celles-ci sont :
- Visuelles : les couleurs se mélangent et les objets semblent prendre vie
- Auditives : les sons semblent faire écho et les voix sont non reconnaissable
- Spatio-temporelles : le temps se suspend et l’environnement physique se déforme
Réponse : Question “piège”, tous les effets mentionnés peuvent être ressentis.(2) Hallucinations visuelles, auditives, spatio-temporelles mais aussi olfactives et tactiles. D’autres signes physiques peuvent apparaître tels que des tremblements, des vertiges, une augmentation du rythme cardiaque ou encore la dilatation des pupilles. Les effets du LSD apparaissent environ 1 heure après la prise de la drogue et peuvent durer pendant 12 heures.
Lire aussi : Drogues : liste, effets et dangers sur la santé
3 – Quand peut-on devenir accro à l’héroïne :
- dès la première prise
- en 2 semaines avec une consommation quotidienne
- si elle est ingérée en intraveineuse, mais pas si elle est fumée
Réponse : L’héroïne est une drogue dite à “tolérance facile”, c’est-à-dire qui provoque rapidement une forte dépendance, en quelques semaines, voire quelques jours seulement.(3)
4 – Le Bad Trip est une mauvaise expérience liée à une consommation de drogue qui provoque généralement une très forte angoisse. Cela concerne :
- 1 consommateur sur 2
- 1 consommateur sur 5
- 1 consommateur sur 10
Réponse : Près de la moitié des jeunes consommateurs (49 %) ont expérimenté un bad trip – des émotions négatives (anxiété, peur) – du fait de leur consommation de drogues.(4)
Lire aussi : Mon ado fume du cannabis : que faire ?
5 – Le cocktail drogues/alcool multiplie par combien le risque d’avoir un accident mortel sur la route ?
- par 5
- par 17
- par 29
Réponse : Le cocktail drogues/alcool multiplie par 29 le risque d’accident mortel.(5) Le cumul des substances induit chez le consommateur un sentiment de puissance et de désinhibition, conjugué à une diminution des réflexes, qui le rendent particulièrement dangereux sur la route, pour lui et pour les autres.
6 – Quelle part des accidents mortels sur les routes impliquent des conducteurs ayant consommé des drogues ?
- un sur 10
- un sur 5
- un sur 2
Réponse : Chaque année, un accident mortel sur cinq implique un conducteur positif aux stupéfiants, cela représente environ 700 personnes tuées par an.(6) Cette part passe à un tiers des accidents, la nuit au cours des week-ends.
Lire aussi : Le gaz hilarant : c’est pas si marrant !
(1) INRS
(2) CAMH
(4) Baromètre des addictions 2021 Macif-Ipsos