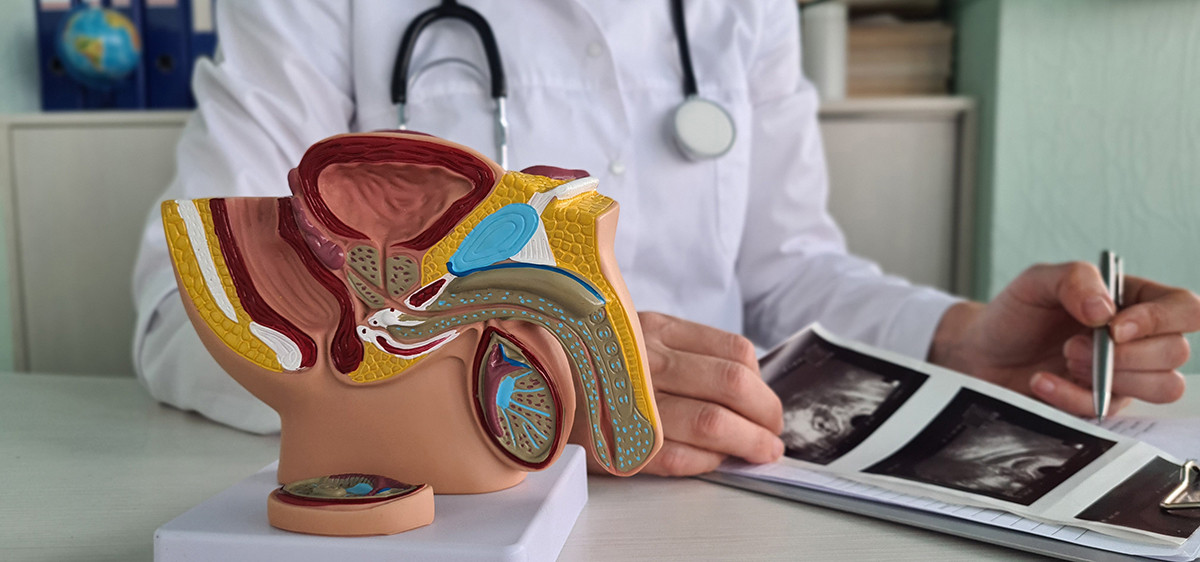Le grand bonheur qui accompagne l’annonce d’une grossesse désirée est, en général, accompagné d’une batterie de recommandations faites aux femmes enceintes. On les invite à procéder au dépistage prénatal (qui vise, notamment, à dépister la trisomie 21 chez les fœtus), à surveiller leur prise de poids et un possible diabète gestationnel. Mais on ne les informe pas toujours sur les risques de prééclampsie, probablement pour ne pas générer d’anxiété. Mais savoir reconnaître les signes qui doivent alerter permet pourtant de sauver des vies.
Qu’est-ce que la prééclampsie ?
Cette maladie est due à un dysfonctionnement du placenta, cet organe temporaire qui relie l’embryon à la paroi utérine de la femme enceinte pendant la grossesse. « Le rôle du placenta, explique le professeur Olivier Morel, du Collège national d’obstétrique, est d’apporter tout ce dont le bébé a besoin en termes de nutriments et d’oxygène. Il est indispensable pour le développement du bébé et pour la tolérance de la grossesse par le corps de la mère. On parle de prééclampsie, quand le placenta ne fonctionne plus correctement pour assurer l’interface entre la mère et le bébé. » Hélas, comme le précise le spécialiste, « c’est une maladie qu’on ne comprend pas encore complètement. Il y a beaucoup de recherches sur ce sujet. Sans qu’on sache pourquoi, à un moment donné, pour certaines femmes, pour certaines grossesses, le placenta dysfonctionne et ne joue plus ce rôle de tolérance ». Le diagnostic est généralement établi lorsqu’on constate une hypertension et des protéines dans les urines de futures mamans. « C’est pourquoi ces deux tests sont proposés à toutes les femmes enceintes, en suivi courant, pendant la grossesse », justifie le professeur Morel. Il indique qu’en cas d’hypertension, des maux de tête inhabituels qui ne passent pas malgré une prise de paracétamol, ou un œdème (gonflement) anormal, doivent alerter. « Au moindre doute, il ne faut pas hésiter à consulter », insiste-t-il.
Comment l’arrêter ?
« Si on laisse évoluer la prééclampsie, ajoute le gynécologue, tous les organes de la mère vont dysfonctionner les uns après les autres. » La tension va continuer à monter, le dysfonctionnement des reins peut conduire à une insuffisance rénale, celui du foie à une insuffisance hépatique, etc. « Or, aujourd’hui, il n’y a strictement aucun traitement qui permet d’améliorer le fonctionnement du placenta, déplore-t-il. On peut recourir à un traitement antihypertenseur pour limiter les conséquences de l’hypertension, mais la seule façon d’arrêter la prééclampsie, c’est de retirer le placenta, donc de mettre fin à la grossesse. Et cela pose beaucoup de questions, notamment car la prééclampsie peut intervenir tôt dans la grossesse, dès 22 semaines. »
Stopper la prééclampsie peut donc avoir pour conséquence des naissances prématurées. C’est pourquoi les professionnels de santé ont pour mission de trouver un équilibre entre poursuivre la grossesse pour limiter la prématurité, et provoquer l’accouchement pour limiter les complications qui pourraient survenir pour la maman.
Quelles conséquences pour la mère et le futur bébé ?
Malgré le retrait du placenta, la guérison des femmes n’est pas toujours immédiate. Selon Olivier Morel, dans les formes les plus sévères de prééclampsie, cela peut même prendre plusieurs semaines. Les mères et les enfants sont alors hospitalisés sur de longues périodes. « Dans les cas les plus compliqués, déplore le médecin, des femmes conservent une insuffisance rénale. Il peut aussi y avoir des séquelles cérébrales et au niveau du fonctionnement du foie. » Les femmes qui ont connu une crise de prééclampsie vivent, en plus, avec un risque élevé de développer une hypertension ou des pathologies cardiovasculaires. Et, malheureusement, les cas les plus sévères peuvent causer des décès. Bien que peu connue, la prééclampsie concerne 3 % des grossesses, et 1 % dans ses formes les plus sévères. Il est donc urgent de faire de la prévention. Olivier Morel recommande aux femmes concernées de contacter l’association Grossesse Santé contre la prééclampsie, dont il est un des conseillers scientifiques, pour s’informer.