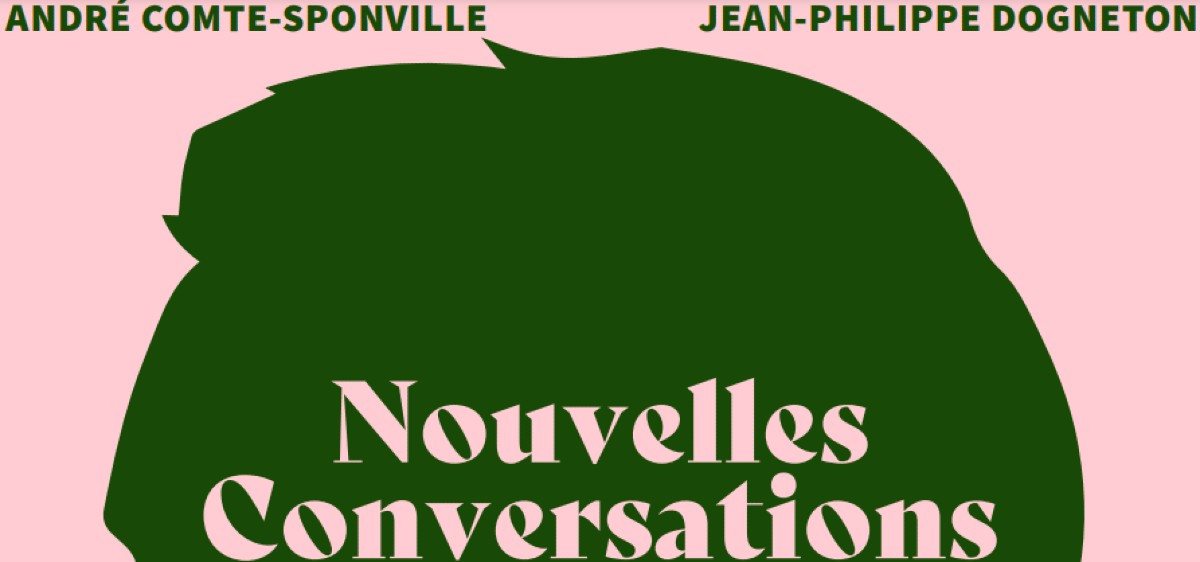Pomme, orange, banane, citron ou kiwi, nombreux été les fruits présents sur les mini-stands de ce marché pas comme les autres qui s’est tenu en mars 2024. « C’est un marché dédié à 100 % aux enfants, c’est-à-dire que les enfants sont soit des clients soit des vendeurs, explique Monique Rubin, présidente de la Fédération nationale des Marchés de France venue superviser l’événement. Ce concept est né à Valence il y a sept ans. Avec le maire de la ville, nous avions besoin d’une nouvelle activité pour le Valence en gastronomie festival, quelque chose de tourné vers les enfants. C’était bien tombé, car j’avais vu chez mon partenaire Vitabri un petit stand tout beau, tout mignon, comme ceux que vous voyez ici. C’était comme un flash. J’ai donc demandé à acheter dix de ces stands à mettre dans un seul camion pour sillonner les villes de France et proposer nos animations. »
Faire la différence entre le bon et le fade
Au total, 160 enfants, âgés entre 6 et 12 ans et venus de trois établissements scolaires différents, garnissent la place. Entre eux, les écoliers font leurs courses avec une monnaie fictive mise gratuitement à disposition à l’entrée du marché : le Fruitatou. « Est-ce qu’on peut faire des promotions avec une carotte achetée pour une deuxième offerte ? », demande le jeune Hugo, visiblement à l’aise dans son rôle de commerçant. Pour les parents comme Leïla et Amine, proches des rambardes délimitant l’accès au marché, c’est aussi l’occasion de voir leurs enfants au contact de la vie marchande. « Grâce à ces ateliers, nos enfants apprennent à choisir de bons produits, mais aussi le quotidien de la vente ou l’achat, il y a un aspect commercial intéressant, explique la mère. Nous habitons La Voulte depuis quelques années maintenant, et nous pensons aux agriculteurs à côté de chez nous qui souffrent de la concurrence des pays étrangers, de la production de masse. Pourtant, leurs produits sont d’excellente qualité. »
Fournisseur des fruits et légumes pour cette deuxième édition du Marché des Enfants à La Voulte-sur-Rhône, David Bucher est ravi d’avoir été choisi pour cette initiative destinée à sensibiliser les enfants au « bien manger » et faire découvrir l’univers du marché avec une participation concrète. « J’ai également des enfants à la maison donc je leur ai appris à connaître les différents fruits et légumes, explique le maraîcher de 45 ans. Cela démontre que pour s’alimenter, il n’y a pas que les supermarchés et qu’il existe d’autres moyens d’accéder à des produits frais. Personnellement, je ne fais que dans les produits bios. Et il faut le dire, c’est un autre goût quand on le déguste ! Par exemple, mes enfants mangent parfois à la cantine et ce n’est pas forcément qualitatif. Quand je vois les pommes que ma fille me ramène de l’école, c’est même dégoûtant… Mais au moins, cela permet de bien faire la différence entre le bon et le fade. »

« En 2024, nous prévoyons une douzaine de Marché des Enfants »
Au total, près de 150 kilos de fruits et légumes frais ont été répartis dans les différents sacs des enfants. Seules quelques mandarines sont restées dans les caisses en bois… Venu observer sa fille et son fils, Amine abonde dans le sens des circuits courts. « Des tomates bien rouges, rondes et grosses, mais qui viennent d’Espagne, nous évitons de les consommer, explique le père de famille. Le fruit est beau d’apparence, mais les produits utilisés modifient la qualité et le goût. Quand j’étais petit au Maroc, ma grand-mère avait son potager. Elle faisait pousser des tomates et des poivrons. Souvent, ils n’étaient pas parfaits visuellement, mais on pouvait les sentir de loin. J’étais sur le palier de la porte d’entrée et je sentais les tomates. Maintenant, tu peux aller en grande surface et prendre une tomate, puis l’ouvrir pour la mettre devant ton nez, tu ne vas rien sentir. Même au moment de cuisiner, l’odeur ressort à peine. C’est presque devenu du plastique ! Alors honnêtement, je préfère payer 2 ou 3 euros de plus en sachant que je mange quelque chose de bon. »

Grâce à cet élan pédagogique, le Marché des Enfants s’intègre progressivement aux différents marchés de France. « En 2024, nous allons faire au moins une douzaine de marchés soit un par mois, évoque Monique Rubin, également présidente des syndicats des marchés de Drôme-Ardèche. Aujourd’hui, c’est un petit format. Dans le festival de Valence en gastronomie, ce sont 1100 enfants sur deux jours qui viennent pour le marché, mais aussi des ateliers pour le dessin, des quizz… En fonction du temps que nous avons, nous nous adaptons. Nous avons déjà œuvré pour les marchés de Martigues, Marignane, Sceaux, Amiens, Caen… Il y en a pour tout le monde et dans différents cadres. »
- Lire aussi : Manger de saison : calendrier et conseils !
À la fin de la matinée, le Marché des Enfants de La Voulte referme ses portes et les écoliers retournent à leur pain quotidien. Depuis son stand pour adultes, David porte un regard plein d’espoir sur ce passage de témoin entre les retraités qu’il considère comme ses principaux clients et la nouvelle vague. « Là, nous parlons de l’alimentation, de la santé, de l’avenir des gamins, conclut le marchand. C’est manger avec de bonnes vitamines, sans pesticides ! Mes grands-parents étaient agriculteurs donc j’ai été sensibilisé à cela et j’ai poussé dans ce sens. L’idée, c’était de diversifier les fruits et légumes, sélectionner des produits de saison. Ne pas manger des fraises en décembre, cela s’apprend ! C’est une éducation pour les années futures. » Au-delà des slogans, bien manger s’associe sans doute au début du bonheur.
Aux quatre coins de la France
Action menée par la Macif avec la Fédération Nationale des Marchés de France, le Marché des enfants valorise notamment les commerces de proximité en plein air, les circuits-courts et l’alimentation équilibrée après des 6-12 ans.