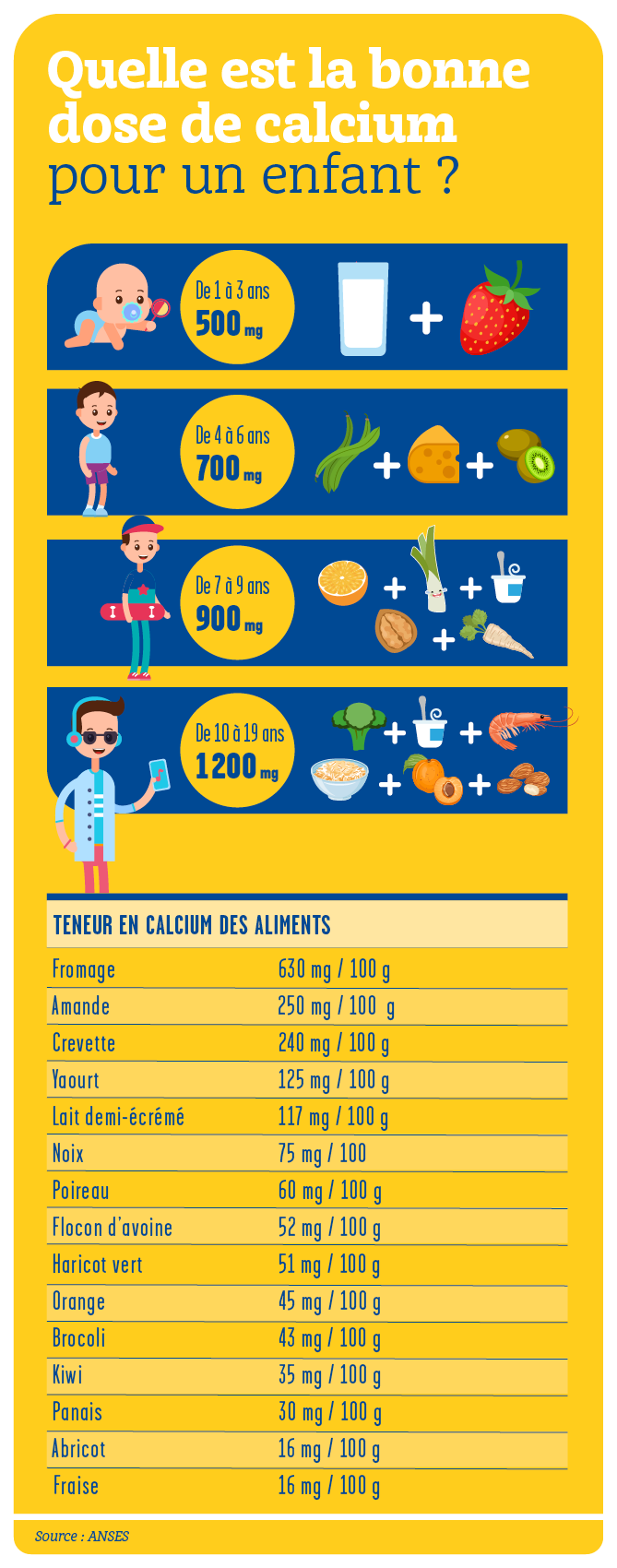La sieste est une pratique très culturelle. « Dans les sociétés d’Europe du Nord, par exemple, elle est plutôt mal vue et se pratique peu. On considère que c’est un signe de paresse et que les personnes qui font la sieste ne veulent pas travailler. Tandis qu’en Europe du Sud, en Asie, ou en Afrique, c’est quelque chose d’admis », indique Raphaël Heinzer, professeur associé à l’Université de Lausanne, et médecin chef au Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS). « Nous sommes dans une société qui a tendance à limiter le temps de sommeil pour avoir plus de temps pour le travail ou les loisirs. Beaucoup de personnes ont un manque chronique de sommeil et la sieste permet de compenser, en partie, ce manque. »
1
La sieste pour chasser le stress
Un sommeil nocturne insuffisant ou perturbé peut provoquer des troubles durant la journée. « Ils se manifestent notamment au niveau cérébral, avec une mauvaise mémoire, une baisse de l’attention, des sautes d’humeur et une forme de stress », explique Raphaël Heinzer. En effet, le manque de sommeil augmente les hormones de stress dans le corps. « Des études montrent que les personnes qui n’ont pas assez dormi la nuit voient leurs hormones de stress baisser lorsqu’elles font une sieste l’après-midi », indique le docteur.
Chiffre-clé
27 % des Français font au moins une sieste par semaine. (1)
2
La sieste pour booster ses performances
« Certaines études révèlent qu’une sieste, même brève (entre 20 et 30 minutes), permet de consolider la mémoire. Par exemple, si on vous donne une liste de mots et que l’on vous demande de la restituer une heure après, vous serez meilleur si vous avez pu faire une sieste entre le moment où vous avez appris cette liste et le moment où vous la restituez », affirme Raphaël Heinzer. Ainsi, en plus du sommeil nocturne, une sieste, même si elle ne correspond pas à un cycle complet de sommeil, peut avoir un effet favorable sur la consolidation de la mémoire.
Autre bénéfice du « petit somme », celui de limiter les accidents de la route ou du travail. « Le fait d’être fatigué durant la journée à cause d’un manque de sommeil peut favoriser les accidents. Faire une sieste permet justement de contrecarrer ce déficit d’attention, d’améliorer la vigilance et d’éviter la somnolence au volant », souligne le docteur. La sieste s’avère également bénéfique pour la productivité, la concentration et la créativité. Elle permettrait de retrouver l’énergie brûlée pendant la matinée et repartir sur les chapeaux de roues pour le reste de la journée.
« Nous disposons de données qui révèlent qu’une sieste, même brève de 20 ou 30 minutes, permet de consolider la mémoire. »
Raphaël Heinzer, médecin chef au Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) et professeur à l’université.
3
La sieste pour prévenir certaines maladies
La sieste semble également bénéfique pour prévenir les maladies cardiovasculaires. « Nous avons mené une étude sur plus de 3 000 personnes, à Lausanne. Elle a montré que, sur une période de cinq ans, les personnes qui ont fait des siestes une à deux fois par semaine avaient moins de maladies cardiovasculaires, que celles qui n’en faisaient pas », avance Raphaël Heinzer. Autre atout : la sieste joue sur la sensibilité à la douleur. « Les personnes en manque de sommeil sont plus sensibles à la douleur », note le spécialiste du sommeil.
À savoir
La sieste à proscrire pour les insomniaques
Pour les personnes qui rencontrent des difficultés à s’endormir ou qui ont de fréquents réveils nocturnes, « il est déconseillé de faire la sieste parce qu’elles risquent d’être moins fatiguées au moment de dormir le soir et d’avoir un sommeil plus fragmenté encore », prévient Raphaël Heinzer.
4
Comment réussir sa sieste ?
On distingue deux phases propices au sommeil réparties sur 24 h : la phase nocturne où le cerveau est prêt à dormir et en début d’après-midi, où naturellement, le cerveau a tendance à s’endormir plus facilement. « Beaucoup de personnes ont tendance à somnoler en début d’après-midi. Tout le monde attribue cela à la digestion du repas de midi, mais en réalité, même si on ne prend pas de déjeuner, on connaît un peu cette somnolence », fait remarquer le docteur.
À savoir
Faire une sieste immédiatement après avoir mangé est déconseillé car la position allongée induit une stagnation plus longue des aliments dans l’estomac et donc un ralentissement de la digestion. Dans la mesure du possible, mieux vaut patienter deux heures après le déjeuner pour faire votre sieste.
Il existe deux types de sieste : la turbo sieste (ou la micro-sieste) durant laquelle, on reste en sommeil léger ou intermédiaire. Pour ce type de sieste, il est recommandé de dormir entre 10 et 20 minutes (voire 30 minutes maximum). Cela offre un sommeil réparateur tout en évitant de plonger dans un sommeil profond. L’autre type de sieste, comme le font les Espagnols par exemple, est plus longue. « Elle dure environ une heure et demie, ce qui correspond à un cycle complet de sommeil. Ce type de sieste est aussi très bénéfique. »
Pour éviter les difficultés à émerger, l’important est de se réveiller hors de la phase profonde du sommeil. « Si on se réveille en sommeil profond, on est plongé dans une sorte d’inertie, et on se sent un peu vaseux pendant un certain temps. »
Le saviez-vous ?
Un cycle de sommeil moyen dure environ 90 à 110 minutes. Idéalement, pour une sieste efficace, il est préférable de dormir moins de 30 minutes ou plus de 90 minutes, selon le médecin du sommeil.
5
S’endormir sur commande
« Pour trouver le sommeil rapidement, il convient d’être dans un environnement calme et dans la pénombre (vous plonger dans le silence absolu et le noir complet n’est pas une obligation). On peut mettre des écouteurs avec un peu de musique douce pour s’isoler du bruit et prévoir un réveil pour se rassurer et éviter de partir pour deux heures de sieste », conseille le spécialiste du sommeil.
La position est aussi importante. Si vous en avez la possibilité, essayez de vous allonger car cela renforce, au réveil, la sensation d’avoir vraiment (et plus longtemps !) dormi. Il est toutefois préférable de vous installer sur un canapé ou un tapis de yoga posé au sol, par exemple, que sur un lit. Ce dernier étant associé au sommeil « longue durée » de la nuit par votre cerveau, vous risquez de perturber votre cycle de sommeil naturel en mélangeant ces phases. « Pour réussir à s’endormir, il faut que le tonus musculaire puisse se relâcher sans que la tête ne tombe en avant ou en arrière. Cela pourrait perturber la qualité de la sieste. Être bien calé permet aux muscles de se relâcher et de s’endormir plus facilement », conclut-il.
Vos nuits sont agitées ?
Si vous êtes adhérents au contrat Garantie Santé, participez au programme TheraSomnia de Santéclair et retrouvez le sommeil naturellement !
L’Essentiel de l’article
- La sieste permet de lutter contre le stress, booster sa mémoire et prévenir certaines maladies.
- L’idéal est d’attendre deux heures après le repas pour faire la sieste.
- La sieste est à proscrire chez les personnes insomniaques.
- Prévoir un réveil pour éviter de se réveiller en sommeil profond.
(1) BEH, Le temps de sommeil en France, 2019