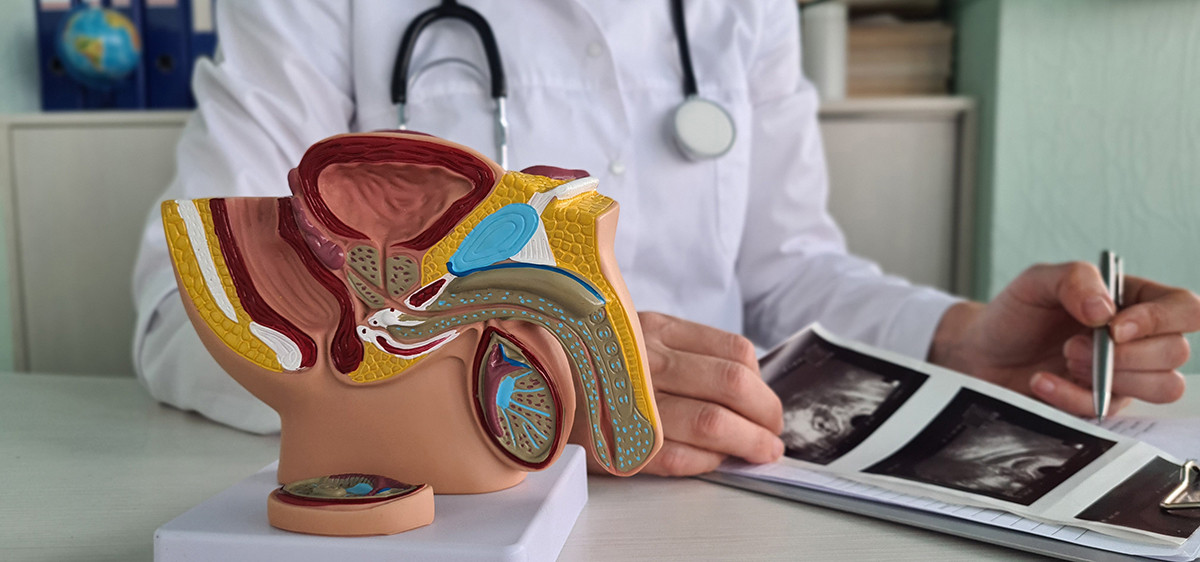Autisme chez l’enfant : de l’observation et de la patience
Six ans. C’est le temps qu’il aura fallu à Marion Viol pour obtenir un diagnostic : « Trois ans pour que l’on me déculpabilise et trois ans pour me confirmer que mon fils présentait bien des signes d’un Haut Potentiel Intellectuel (HPI) et des troubles du spectre autistique (TSA) », précise-t-elle. Pourtant, dès les premiers mois qui suivent l’accouchement, cette jeune maman sent bien que quelque chose ne va pas : « Il n’aimait pas les chatouilles, il n’aimait pas que je lui chante des chansons… Toutes ces petites choses que les mamans font naturellement, chez moi, rien ne fonctionnait. »
- Lire aussi : Troubles du neurodéveloppement chez l’enfant : comment les détecter et quand consulter ?
Comment l’expliquer ? À cette question, Marion Viol répond avec culpabilité : son fils étant le premier enfant, son inexpérience en est forcément la cause. Mais très vite, elle remarque chez ce petit garçon des capacités mémorielles exceptionnelles. « Il n’avait que deux ans et avait déjà mémorisé toutes les marques et modèles de voiture, se souvient-elle. Dès qu’il voyait les phares d’une auto, il me donnait dans l’instant la marque et le modèle. » Un signe bien loin des classiques « il ne regarde pas dans les yeux » ou « il ne pointe pas du doigt », mais un signe malgré tout. « Contrairement à ce que l’on pourrait penser, comme parfois même certains pédiatres, l’autisme ne repose pas uniquement sur le fait qu’un enfant va regarder ou non dans les yeux », déplore la jeune maman.
Premiers signes autour de 18 mois
C’est ce que confirme Frédérique Bonnet-Brilhault, pédopsychiatre et responsable du département universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du CHRU de Tours (et coresponsable d’une équipe de recherche INSERM, l’équipe Autisme et neurodéveloppement de l’Unité IBrain, ndr) : avoir des intérêts particuliers, aimer des jeux atypiques, présenter des particularités sensorielles, réagir de manière très forte à des petits bruits ou à certains touchers, être trop mou ou hypertonique… « Les signes sont nombreux, appuie-t-elle. Mais, si les parents ne reconnaissent pas l’autisme en soi, vous pouvez être sûrs qu’ils voient que sur certains aspects, la communication, la relation ou l’imagination de leur enfant ne se développent pas correctement. » De manière générale, c’est autour de 18 mois que l’autisme se manifeste. Mais il arrive que des formes plus légères ne se remarquent que vers l’âge de 2 ans et demi, lorsque l’enfant débute sa scolarisation. « Il est plus “facile” d’observer les premières difficultés de socialisation d’un enfant lorsqu’il est en groupe », explique la médecin.
Troubles de développement : des parents démunis
Au total, ce sont huit psychologues qu’ont consultés Marion et son compagnon. Sans succès. Entre ceux qui n’excluent pas la responsabilité de la mère et ceux qui sont totalement désarmés face aux troubles neurodéveloppementaux, le tunnel semble dénué de lumière. « Et ce n’est pas qu’une question de génération, estime Marion. J’ai pu rencontrer de jeunes professionnels de santé qui avaient les mêmes réflexions, les mêmes idées reçues, ce qui est bien plus inquiétant. S’ils ne sont pas à la page, soit. Mais qu’ils nous orientent vers quelqu’un d’autre. Lorsque vous souffrez en tant que parent, que vous êtes à court de solutions mais qu’on vous dit que c’est tout de même à vous de trouver des solutions, c’est très dur. C’est quelque chose qu’on ne peut pas entendre, c’est trop violent, trop injuste. »
Si Frédérique Bonnet-Brilhault reconnaît que le nombre de médecins maîtrisant les troubles du neurodéveloppement est encore insuffisant, elle tient tout de même à souligner un effort de formation ces dernières années. « On sent que les choses changent, estime-t-elle. Vous avez notamment l’implantation dans chaque département de ce qu’on appelle les “plateformes de coordination et d’orientation”. » Lorsque le médecin traitant repère aux côtés des parents une trajectoire de développement différente, il peut solliciter cette plateforme qui va alors déclencher toutes sortes de bilans (orthophonique, psychomoteur, psychologique…). « Malheureusement, elles sont assez récentes (2019, ndr), tempère la pédopsychiatre. Il faut encore attendre pour que ces nouvelles plateformes soient parfaitement opérationnelles. Mais il est vrai que dans le domaine de la santé développementale, le temps est long. Si vous avez une enfant pour qui l’on suspecte une leucémie, les choses vont aller très vite. Lorsque c’est un problème de santé développementale, on réagit bien plus lentement alors que le temps compte aussi. »
Après le diagnostic, le quotidien avec l’autisme
Aujourd’hui, le fils de Marion a 9 ans et est suivi par une pédiatre, basée à Quimper – « soit à 15 km de mon domicile » –, spécialisée dans les troubles du neurodéveloppement : le Dr Sarah Doukhan-Becourt. Entre-temps, l’autisme s’est une nouvelle fois invité dans la famille, chez sa fille cadette. C’est pourquoi, à 39 ans elle a décidé de publier un livre intitulé La Théorie de la chaussette (paru en mars dernier, ndr), dans lequel elle raconte son quotidien : celui d’une mère dont les deux enfants souffrent de troubles du spectre autistique. « Le plus dur est passé, car une fois le diagnostic posé, vous pouvez trouver des prises en charge adaptées. Sans oublier le fait que le diagnostic donne une légitimité vis-à-vis de l’école et d’autrui. On cesse de vous faire douter, de vous culpabiliser. Ce qui ne change pas, c’est les journées rythmées par les crises, l’inquiétude et les angoisses lorsque vous pensez à l’avenir de votre enfant… »
Comment faire face ? Pour Marion, l’essentiel est de se faire confiance en tant que parent. Et surtout, ne pas hésiter à continuer de poser des questions, et à changer de professionnel si ce dernier ne convient pas. Une remise en question permanente et indispensable, selon cette maman qui tient également à rassurer les futurs parents d’enfants autistes : « Qu’ils se sentent libres de craquer, c’est tout à fait normal. On a le droit de pleurer, on a le droit de crier. Et ce, tous les jours. »
Besoin d’un suivi médical ?
Découvrez Macif Mutuelle Santé, une complémentaire qui s’adapte à vos besoins