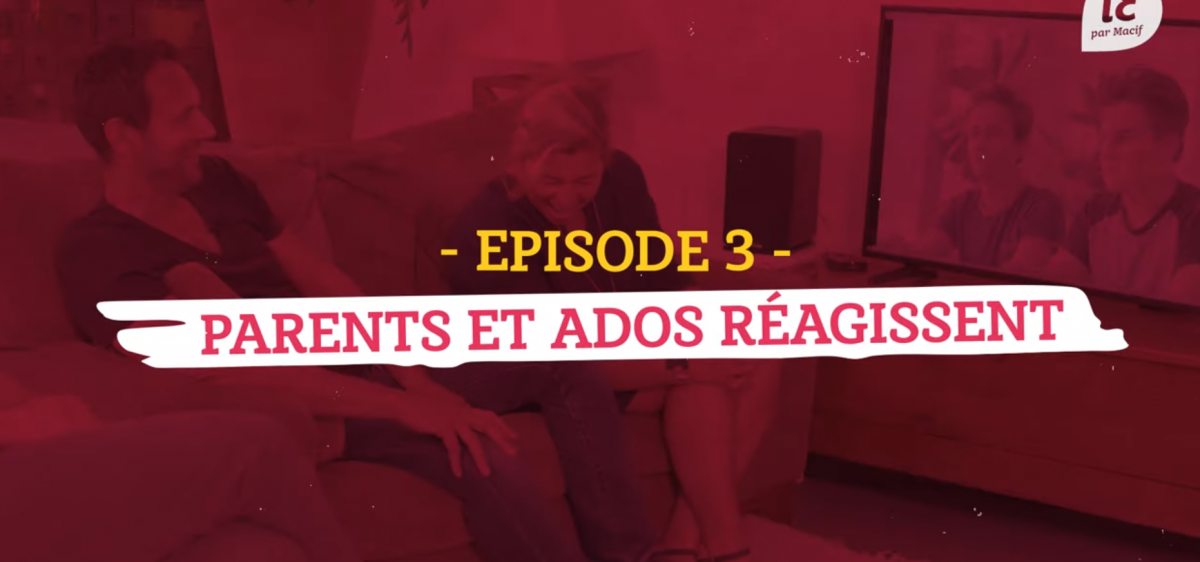Sylvie, retraitée périgourdine, vient d’emménager dans un petit logement de plain-pied qu’elle a fait construire… dans son jardin ! La démarche peut surprendre, mais elle permet à cette sexagénaire de se libérer de la contrainte des escaliers de son ancienne maison familiale, tout en restant en cœur de ville, le tout pour un budget serré.
« Sylvie a d’abord cherché à acheter un terrain dans le centre de Périgueux, mais ce type de bien est très rare » explique Amandine Hernandez, architecte et urbaniste cofondatrice de l’agence Villes Vivantes. Cette dernière a été missionnée par la ville de Périgueux (24) pour piloter l’opération Bimby (initialement Build In My Back Yard, rebaptisée Beauty In My Back Yard, soit De la beauté dans mon jardin). En bref, il s’agit de densifier le tissu pavillonnaire en douceur, en insérant de nouveaux logements (construction d’appartements accessoires, surélévation, extension, etc.) sur les parcelles d’habitants volontaires, sans détruire les logements existants. L’ambition : proposer un habitat qui ne consomme pas de nouvelles terres naturelles et agricoles, tout en répondant aux attentes des habitants, au cas par cas.
Densité urbaine et habitat pavillonnaire : comment limiter les impacts ?
Si les Français préfèrent vivre en maison plutôt qu’en appartement1, ce rêve pavillonnaire a un coût. L’habitat individuel est responsable de 47 % de l’artificialisation nouvelle, contre 3 % pour l’habitat collectif, lequel abrite pourtant près de la moitié des Français2. Or, les conséquences néfastes de cette artificialisation ne font plus débat aujourd’hui : perte de biodiversité, étalement urbain, accroissement des migrations pendulaires et donc des temps et des coûts de transport…
Alors, si construire dans un jardin peut sembler anecdotique, le recours à la densification pavillonnaire peut-il offrir un compromis entre l’idéal de logement des Français et l’urgence écologique et sociale ? Pour Amandine Hernandez, le Bimby offre un précieux point de convergence entre intérêt collectif et particulier. Et son potentiel est réjouissant : si sur cent maisons, deux d’entre elles étaient densifiées avec un nouveau bâti, l’étalement urbain serait jugulé, assure l’architecte.
La démarche rejoint l’objectif de « Zéro Artificialisation Nette » affiché par le gouvernement dans son plan biodiversité de 2018, et qui pourrait prochainement devenir contraignant. Ce dernier est en effet au cœur du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, actuellement présenté en conseil des ministres.
Densifier le tissu pavillonnaire peut donc apparaître comme une solution parmi d’autres – repenser les logements vacants ou sous-exploités, notamment – pour freiner drastiquement l’artificialisation du territoire, tout en répondant à une interrogation pressante de bien des collectivités locales : comment « gagner » de nouveaux habitants et répondre à leurs besoins ?
Lire aussi : Devenir propriétaire jeune fait-il toujours rêver ?
Repenser l’habitat pour une ville mieux partagée
Au-delà de Périgueux, la Communauté Urbaine du Creusot-Montceau, les collectivités des Vosges Centrales ou encore du Grand Nevers ont également fait appel à l’équipe de Villes Vivantes. « Nous pensons qu’une densité accrue peut rendre la ville plus belle : c’est une ville où l’infirmière travaille plus près de l’hôpital, où les retraités peuvent faire leurs courses à pied, où des jeunes couples peuvent acheter un terrain… » défend Amandine Hernandez.
Ce n’est pas Sylvie qui la contredirait. Elle, qui n’avait jamais imaginé que sa parcelle de 458 m2 puisse accueillir deux maisons, vit désormais sur ses 75 m2 de plain-pied (pour un coût de construction maîtrisé, aux environs de 1 300 euros le m2) dotés, en prime, d’un patio et d’une pergola. Quant à sa maison pré-existante, elle a été réhabilitée pour être louée. De quoi assurer un complément de revenu bienvenu…
Un peu plus loin, Céline, qui vit avec sa fille dans un quartier recherché de Périgueux, a fait réaliser deux studios bénéficiant d’espaces extérieurs en soupente de sa terrasse, loués par deux étudiantes. Quant à Hamed et Mohammed, père et fils, ils ont construit sur une même parcelle deux maisons sans vis-à-vis : de quoi vivre à côté tout en préservant l’intimité de chacun…
« Le Bimby à Périgueux, c’est du gagnant-gagnant. Cela permet d’avoir un habitat atypique en plein milieu du patrimoine et aussi de reconquérir des habitants, notamment des familles », écrit la maire Delphine Labails. Depuis les débuts de l’opération en 2016 sur la commune, près de 200 projets de logements ont abouti.
Une densification douce pour des villes durables
Il ne s’agit là ni de la première ni de la seule initiative visant à défendre la densification pavillonnaire. Les pionniers sont sans doute à chercher du côté de nos voisins britanniques. Dès les années 1970, le Granny Flat (« l’appartement de mamie ») séduit de nombreux propriétaires âgés, qui font construire sur leur terrain une maison plus petite avant de mettre en location leur habitation principale.
En France, bien avant le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique, la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbains) de 2000 encourageait déjà les acteurs publics à refaire « la ville sur la ville ». L’injonction a d’abord concerné les zones centrales des agglomérations et les grands ensembles avant de toucher, plus tard, les quartiers pavillonnaires. Mais le phénomène n’est pas sans écueils : une densification spontanée et incontrôlée peut en effet se traduire par l’apparition d’un habitat dégradé, comme cela s’observe dans les tissus pavillonnaires logeant des populations défavorisées, notamment en moyenne couronne francilienne. En l’absence de réel encadrement public, des divisions internes et des extensions abusives répondent à la pression immobilière, au bénéfice de quelques-uns.
Lire aussi : Et si l’architecture low-tech permettait des villes plus durables ?
Par ailleurs, « Si les acteurs publics n’organisent pas de développement économique conjoint à la densification douce des zones périphériques, alors celle-ci ne fait que renforcer les mobilités pendulaires, sans permettre un développement durable des villes », met en garde Rachel Linossier, maître de conférences en Aménagement et Urbanisme à l’Université Lumière Lyon 2. « La densification doit être maîtrisée et encadrée par les collectivités », abonde Amandine Hernandez. « Mais elle doit aussi être désirable. La lutte contre l’étalement urbain ne peut fonctionner que si les habitants y trouvent leur compte », conclut l’architecte.
Des rénovations à entreprendre pour votre nouveau logement ?
Pour les financer, pensez au crédit Travaux Macif !*
* Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.